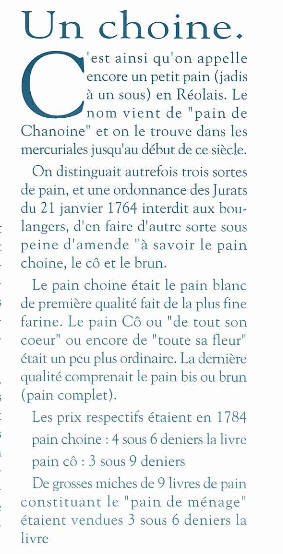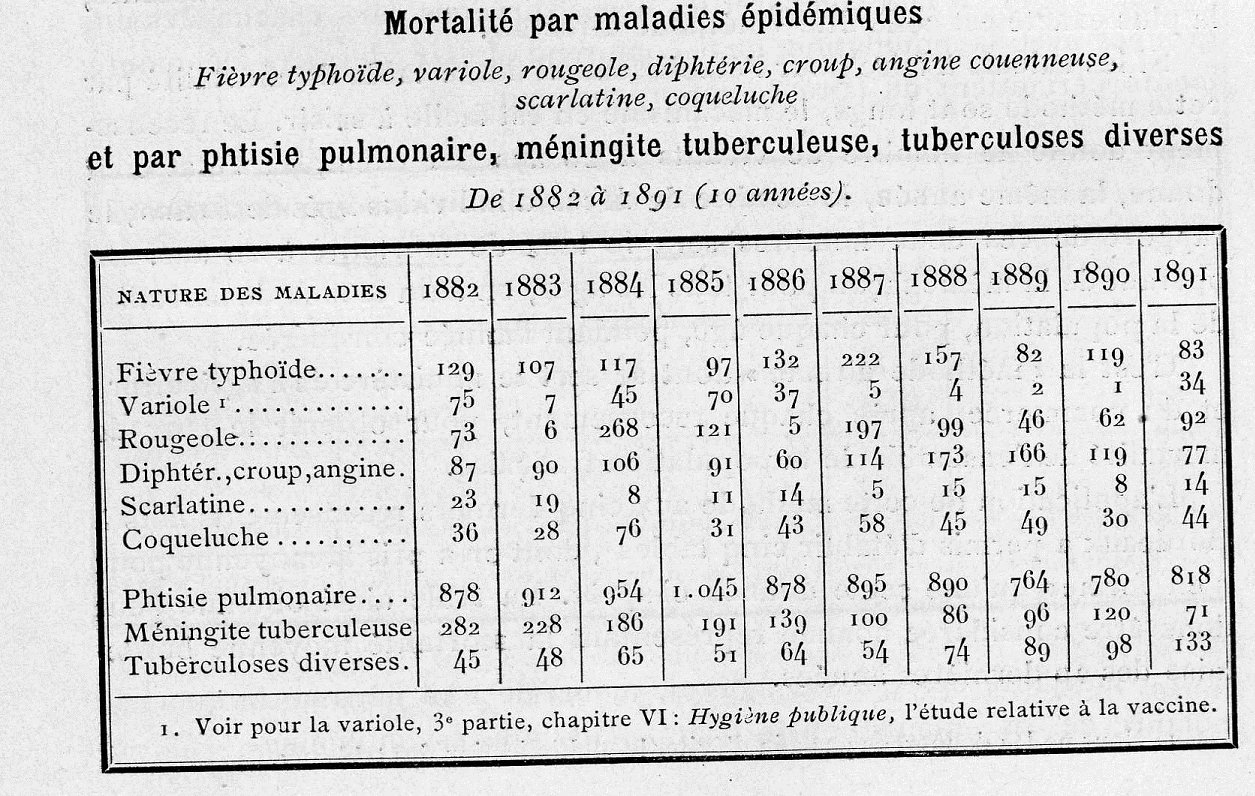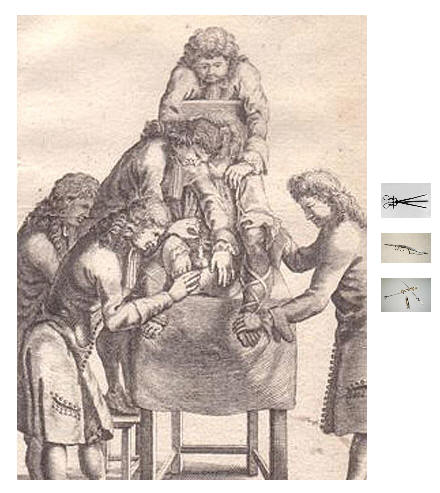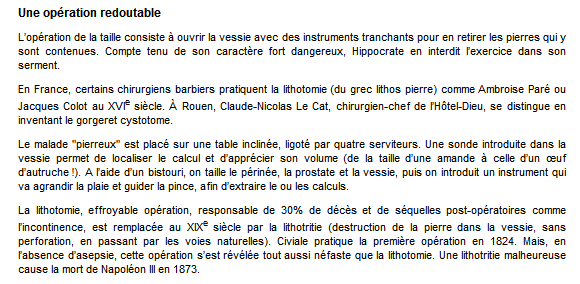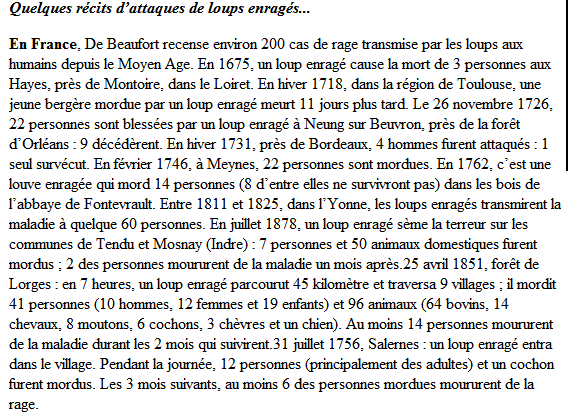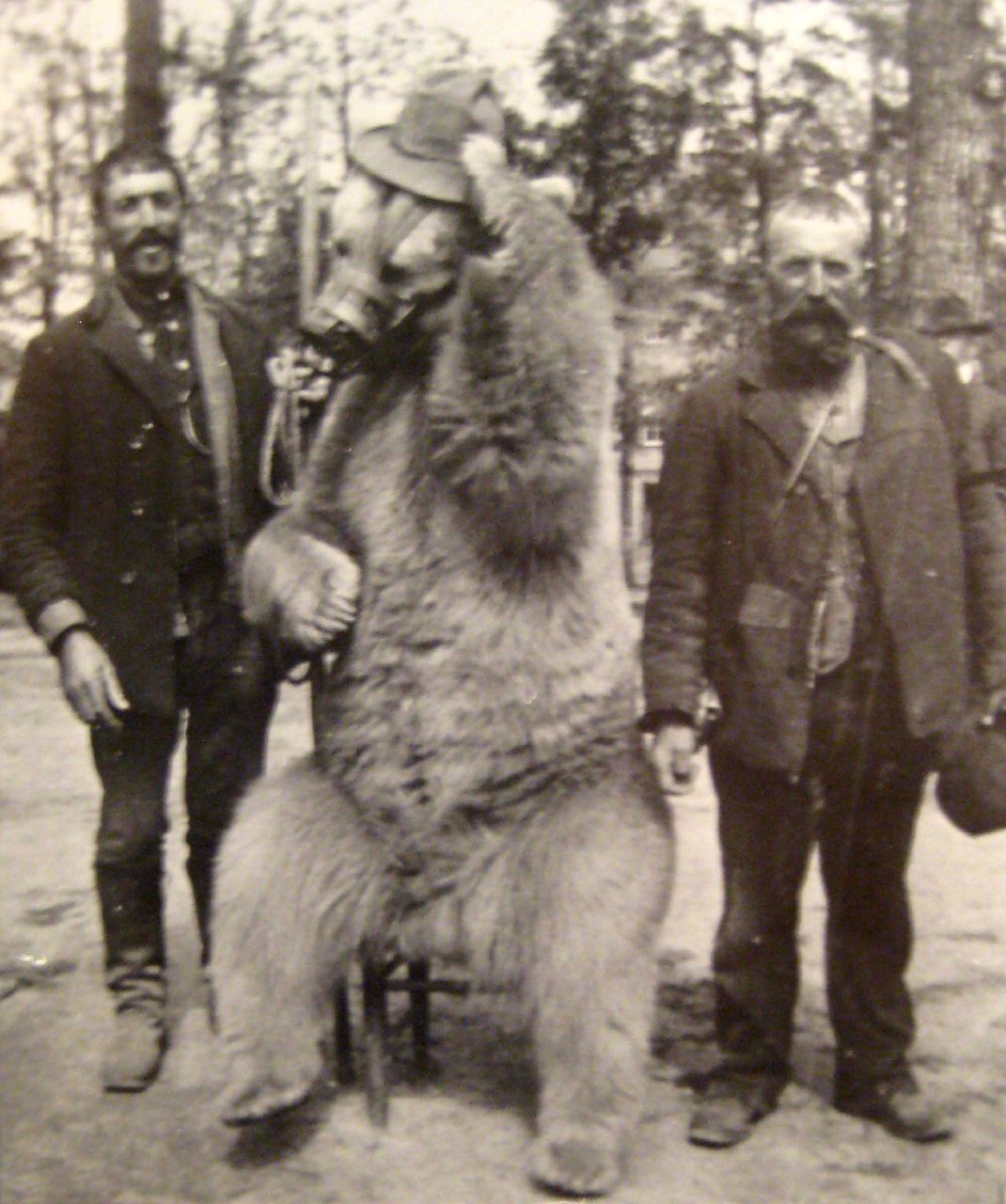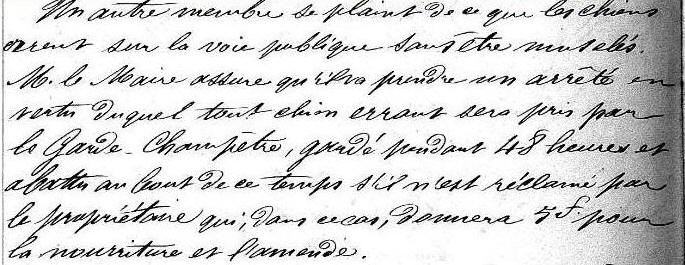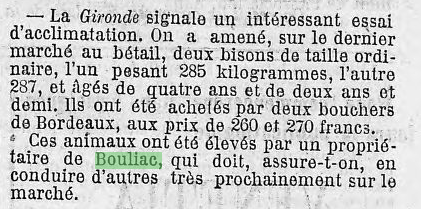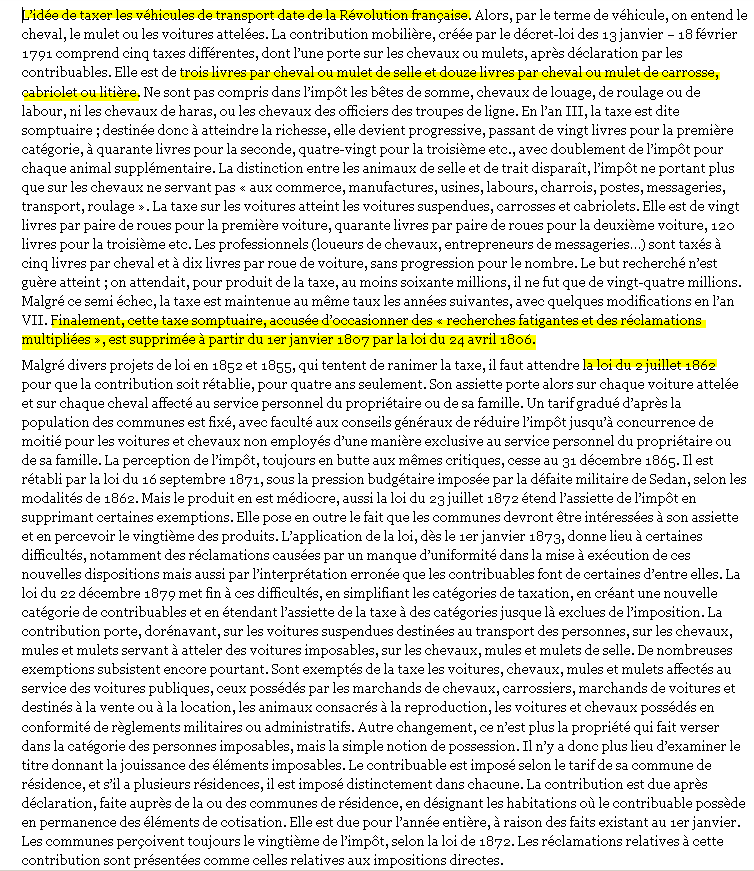Alimentation, santé, animaux
Le pain
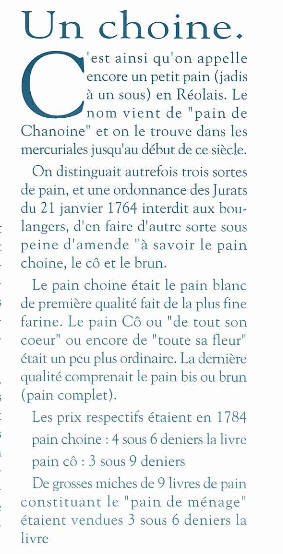 |
Ce que nous dit l'abbé
Pareau
A propos
du ruisseau du Moulin du Pian , appelé aussi ruisseau du Moulin de
Vergne :
"Ce ruisselet a donc eu des jours de gloire. Ses eaux maigres
aujourd'hui, abondantes jadis, ont fait tourner les meules d'un moulin
désigné par deux noms et qui alimentait de blanche farine toute la
contrée.
* * *
Il y a cinquante ans à peine, les grands et les petits propriétaires,
suivant l'usage des ancêtres, semaient du blé, les premiers pour le
vendre, les seconds pour s'assurer, sans bourse délier, le pain de
l'année , et cette "précieuse dépouille de nos sillons" s'en allait au
moulin à eau, ordinairement à dos de cheval ou de mulet, par l'étroit
chemin de la vallée, ou au moulin à vent, par l'abrupte sentier du
coteau. La farine revenait par les mêmes voies et les mêmes moyens au
modeste logis du petit propriétaire. Il était souvent lui-même son
propre boulanger, pétrissant de grand matin et cuisant dans le four
attenant à la maison, son pain, non pour deux ou trois jours , mais
pour deux et trois semaines . Enfant, je l'ai vu faire dans mon petit
village et dans ma propre famille, et le pain cuit n'était pas la
miche délicate et légère, pas même le pain de dix livres, mais ce
gros pain de dix kilos qu'on ne connaît plus, que nous ne verrions pas
sans frémir, et peut-être sans rougir, sur nos tables. Et certes, il
n'était plus frais, au bout de la quinzaine ou du mois, ce gros pain de
ménage, et néanmoins les estomacs d'alors ne se portaient pas plus mal
que ceux d'aujourd'hui, les santés étaient même autrement florissantes.
Les enfants de la maison, qui dormaient le bon sommeil des anges au
moment de la mise du pain au four, assistaient avec un vif intérêt à sa
sortie, car, à l'entrée du gouffre brûlant, se trouvait toujours, cuite
à point, une friande galette. Ces temps ne sont plus ; on ne sème plus
de blé, du moins à Bouliac et aux environs : personne surtout ne fait
plus pain , et je me plains moins que personne de ce dernier progrès,
car il me serait infiniment dur d'utiliser le four de la cure, comme
l'ont fait sans doute , au siècle dernier, mes prédécesseurs, dont l'un
d'eux le bâtit évidemment pour son usage personnel et non pour celui du
du roi de Prusse.
***
|
|
Extrait de Les Cahiers de l'Entre-Deux-Mers, Mai 1995.
|
Le pain, les prix du pain, les boulangers
Le 21 janvier 1784, une ordonnance des jurats de Bordeaux
interdisait aux boulangers, sous peine d'amende, de faire autre chose
que le pain choyne, le co et le brun.
Le pain choyne était le pain blanc car réservé aux chanoines. Le pain
co était le pain plus ordinaire et le brun de dernière qualité.(Tiré de
la rubrique de Guy Suire, Les mots d'ici, du samedi 10 octobre 2009, du
journal Sud-Ouest)
Les maladies
Il est impossible de connaître la mortalité par maladie de la
population bouliacaise. Cependant, une étude sur la mortalité
épidémique par maladie, faite dans le Rapport annuel présenté au
Conseil municipal de la ville de Bordeaux par le maire en 1890, donne
des informations intéressantes. Toutefois, il est impossible de
transposer ces informations, concernant la ville de Bordeaux, à la
petite commune rurale de Bouliac.
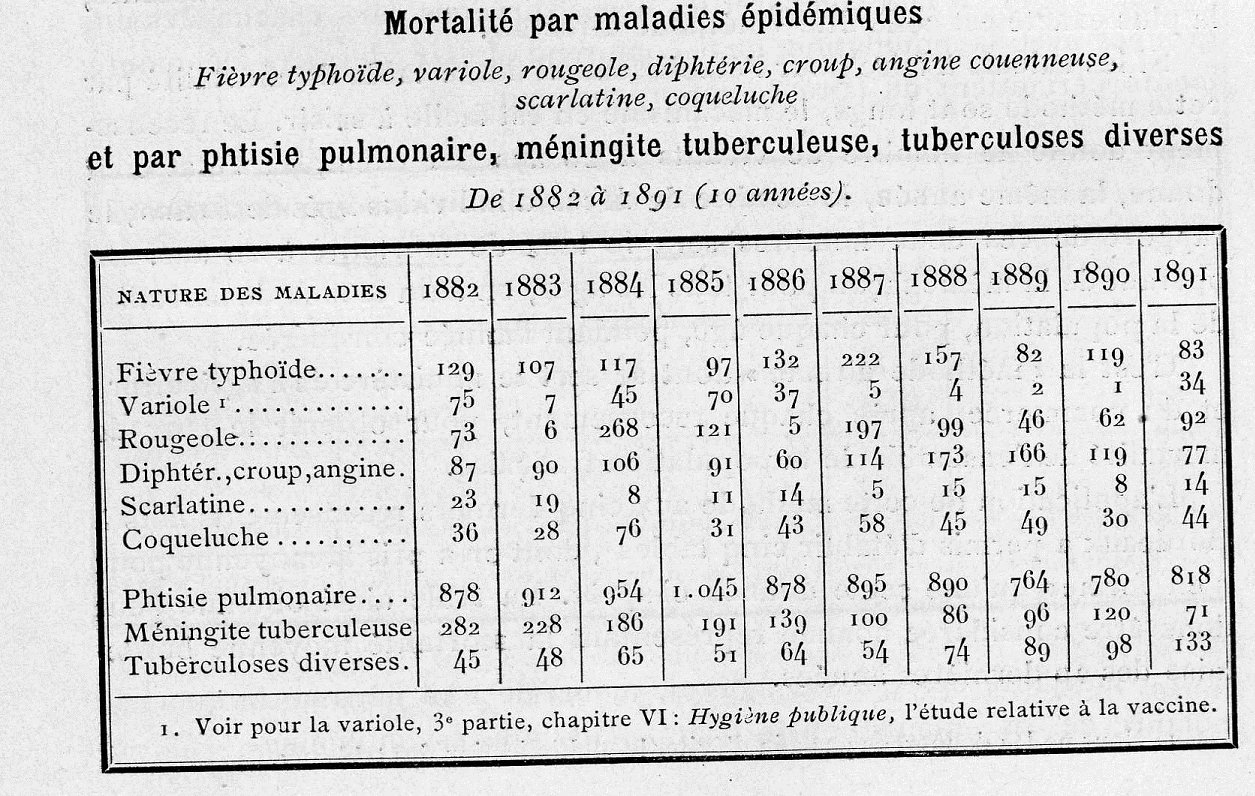
Dans le rapport mentionné, le tableau
est complété par les remarques suivantes: "La fièvre typhoïde est
endémique, à Bordeaux; la mortalité moyenne pendant les 20 dernières
années est d'environ 5 pour 10 000 habitants. La variole, à part
quelques réveils épidémiques, a à peu près complètement disparu. La
diphtérie, le croup et l'anginne couenneuse semblent augmenter. La
rougeole, la scarlatine et la coqueluche sont stationnaires. L'ensemble
des maladies tuberculeuses, qui forment un contingent de mortalité
considérable, ne varie guère non plus."
|
Le saviez-vous ? Sous le
Troisième Empire, le bégaiement était un motif d'exemption pour les
conscrits. Entre 1851 et 1870, un jeune bouliacais fut ainsi dispensé
de ses obligations militaires.
|
La
maladie de la pierre
La plus ancienne
information que
j'ai recueillie est une réponse du maire au préfet, datée du 6
mars 1830 :""pas
un des habitants de la commune de
Bouliac eut été ou fut en ce moment atteint de la maladie de la
pierre."
Quelle est la raison de cet
intérêt pour la maladie de la pierre qui est la plus courante
des pathologies urinaires ? Caractérisée par la formation de
calculs rénaux, elle est appelée de nos jours : lithiase
urinaire. Connue dès l' Antiquité, elle était guérie par
Asclépios à Epidaure, selon la légende.
Celse, auteur romain, 100 ans
après J.-C. a codifié l'opération de la taille vésicale dite
taille au petit appareil qui consiste à inciser le périnée, la
prostate et le col de la vessie, en attirant la pierre en
direction de l'incision sous le contrôle digital de deux doigts
introduits dans le rectum "en dépit des cris de la personne
... comme si la détresse du patient ne l'émouvait en rien."
Il soulignait toutefois que cette opération ne devait être
effectuée qu'en cas d'extrême nécessité.
|
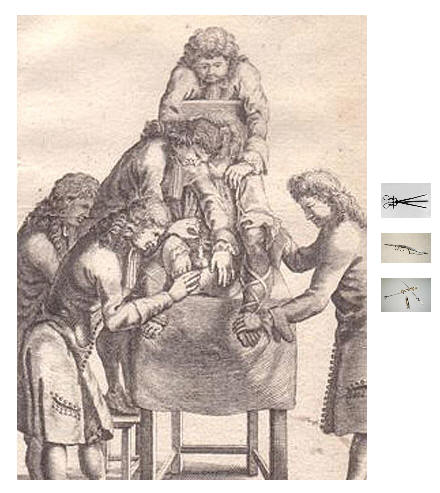
|
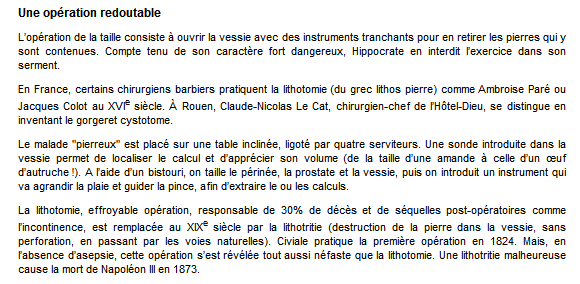
Mais pourquoi le préfet de la
Gironde, en 1830, s'intéressait-il à la maladie de la pierre ?
Encore une question sans réponse
!
|
|

|
La
variole ou petite vérole
On comprend mieux l'intérêt porté
par le préfet à la variole qui était à cette époque une maladie
redoutable.
La variole ou petite vérole est une maladie infectieuse d'origine
virale, très contagieuse et épidémique.
Elle se caractérise en quelque sorte par un "mouchetage de pustules".
L'éruption est caractérisée par l'apparition de taches rouges sur la
peau, devenant des vésicules, puis des pustules avant de former une
croûte. L'étendue en est variable et reste étroitement reliée à
l'évolution de la maladie (une éruption de plus grande taille est un
critère de gravité). Les lésions sont plus fréquentes au niveau du
visage et des paumes. La lésion est rarement hémorragique (saignante),
mais est, dans ce cas, gravissime.
La variole était un fléau redoutable et redouté. Elle tuait un malade
sur cinq (chez les adultes, près d’un malade sur trois). Quand elle ne
tuait pas, elle laissait souvent un visage grêlé, défiguré à vie. Elle
est toujours restée hors de portée d’un traitement efficace.
. La
variole a tué de nombreux hommes célèbres en France,
dont, entre autres, Hugues Capet et le roi Louis XV.
Jeune fille du Bangladesh atteinte de la variole
en 1973.
|
Historique
Connue dans la Chine ancienne où elle aurait été
introduite en l'an 49 de notre ère, il
est généralement
admis que la variole fut introduite en Europe par les invasions
arabes, à la suite de
l'épidémie de la
Mecque en 572. Cependant plusieurs savants ont aussi
voulu voir la variole derrière l'épidémie qui frappa l'Empire
romain durant le règne de Marc Aurèle, couramment appelée peste antonine. Le fléau s'est ensuite répandu dans
le monde entier, causant, au cours des siècles, d'effroyables pandémies responsables de millions de morts. Elle
est notamment la plus virulente des maladies qui décimèrent les
populations amérindiennes lors de la conquête du Nouveau Monde,
dès son arrivée en 1518.
En Inde, la variole est
décrite dans les livres ayurvédiques. Le traitement curatif ayurvédique passait par l'inoculation d'un "matériau
varioleux" vieux d'un an, issu des pustules de personnes
ayant contracté la variole l'année précédente. L'efficacité
de cette méthode a été attestée par le médecin britannique J.Z.
Holwell dans un rapport au College of Physicians à Londres en 1767.
La première mention écrite de
la variole vient d'un médecin d'Alexandrie, Aaron.
Dès le XIe siècle, les Chinois pratiquaient la variolisation : il s'agissait d'inoculer une
forme qu'on espérait peu virulente de la maladie en mettant en
contact la personne à immuniser avec le contenu de la substance
suppurant des vésicules d'un malade. C'est le premier ministre Wang
Dan qui après la perte
d'un de ses fils de la variole avait convoqué divers praticiens
de toute la Chine pour mettre au point une prophylaxie. Un moine taoïste apporta la technique d'inoculation qui
se diffusa progressivement dans toute la Chine.
Mais ces origines précoces
sont remises en causes par certains auteurs et la première
mention indiscutable de la variolisation apparaît en Chine au
XVIe siècle.
Le résultat restait cependant
aléatoire et risqué, le taux de mortalité pouvait atteindre 1
ou 2 %. La pratique s'est progressivement diffusée le long
de la route de la soie. En 1701, Giacomo
Pylarini réalise la
première inoculation à Constantinople.
La technique est importée en
occident au début du XVIIIe siècle, par Lady
Mary Wortley Montagu,
femme de l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Turquie, qui l'apprend
du docteur Emmanuel Timoni (ca 1670-1718), médecin de l'ambassade
de Grande-Bretagne à Istanbul. Diplômé de l'université de
Padoue, membre de la Royal Society de Londres depuis 1703, le
docteur Timoni publie en 1713 dans les Philosophical transactions
de la Royal Society son traité sur l'inoculation. Son travail
est publié de nouveau l'année suivante à Leipzig. À partir de
cette date, les publications sur ce sujet se multiplient,
Pylarino en 1715, Leduc et Maitland en 1722… Elle est
introduite en France plus tard. La première inoculation
véritablement médiatisée est celle pratiquée par le docteur Théodore Tronchin en 1756 sur les enfants du duc d'Orléans. En 1760, Daniel Bernoulli démontra que, malgré les risques, la
généralisation de cette pratique permettrait de gagner un peu
plus de trois ans d'espérance de vie à la naissance. Elle
suscita cependant l'hostilité de nombreux médecins.
Vaccination
de Jenner
Pour la
première fois, des années 1770 jusqu'en 1791, au moins six
personnes ont testé, chacune de façon indépendante, la
possibilité d'immuniser les humains de la variole en leur
inoculant la variole des vaches, qui était présente sur les pis
de la vache. Parmi les personnes qui ont fait les premiers essais,
figurent en 1774, un fermier anglais au nom de Benjamin Jesty, et
en 1791, un maitre d'école allemand du nom de Peter Plett. En
1796, le médecin anglais Edward
Jenner fera la même
découverte et se battra
afin que l'on reconnaisse officiellement le bon résultat de
l'immunisation.
Le 14 mai 1796, il
inocula alors à un enfant du pus prélevé sur la main d'une
fermière infectée par la vaccine (via le contact avec les pis de la
vache infestée), ou variole des vaches (« cow pox »
en anglais). Trois mois plus tard, il inocula la variole à l'enfant,
qui y résista, se révélant ainsi immunisé contre le virus.
Cette pratique se répandit alors progressivement dans toute l'Europe.
Néanmoins, la variole est restée endémique pendant tout le XIXe siècle et n’a progressivement disparu d'Europe
qu’après la Première Guerre mondiale.
En France
En mai 1811, l'héritier impérial a été vacciné contre la
variole par Henri-Marie Husson qui fut immédiatement décoré de la
Légion d'honneur. Il déclara : "Bientôt, nous toucherons à l'époque où
la petite vérole ne sera plus connue que par le souvenir de la terreur
qu'elle inspirait, et par un sentiment de reconnaissance pour la
pratique salutaire qui nous aura délivrés de ce fléau."
Un fléau redoutable comme le montrent les archives de cette
maladie : à Paris, 14000 morts en 1716, 20000 en 1723, 14000 en 1796. A
Bordeaux et dans la campagne environnante, la variole tuait
environ 10% des nouveau-nés avec un nombre équivalent de défigurés,
estropiés, aveugles et "imbéciles".
Napoléon, qui admirait le médecin anglais Jenner, fit réaliser une
expérience sur 50 orphelins militaires avec l'intervention déterminante
du ministre de l'Intérieur Lucien Bonaparte. L'Etat mit alors en place
une politique de vaccination obéissant à deux principes : la
vaccination serait massive ou ne serait pas, elle s'imposerait sans
être imposée. Avec les encouragements fermement exprimés de l'Empereur
, les médecins les plus prestigieux de l'époque et des personnalités
scientifiques importantes, une Société pour l'extinction de la petite
vérole fut créée.
Vaccination contre la variole vers 1820

On vaccina d'abord l'armée, puis les préfets et les maires
organisèrent des campagnes de vaccination et de persuasion des
récalcitrants. Leur tâche était difficile car ils pouvaient publier les
noms des familles frappées par la maladie et ayant refusé la
vaccination mais il leur était interdit de priver ces familles de
certains droits ou de leur imposer un impôt spécial. Contrairement aux
craintes de l'Empereur, l'Eglise, dans une écrasante majorité, soutint
les efforts en faveur de la vaccination. Certains curés profitèrent
même de la cérémonie du baptême pour recommander la vaccination et la
favorisèrent dans les presbytères et les écoles religieuses lors des
séances de catéchisme. Certains curés de campagne allèrent même jusqu'à
pratiquer eux-mêmes la vaccination de façon intensive.
Mais, il y eut des oppositions très vives. Au nom de la
morale, le philosophe Kant déclara que la vaccination constituait pour
l'humanité un "avilissement, puisqu'on introduit en elle une sorte de
bestialité." Certains médecins soulignèrent les dangers de cette
vaccination. Deux d'entre eux, Vaume et Chappon prirent contact avec
les parents dont les enfants auraient été des victimes de cette
pratique préventive. Vaume publia Les Dangers de la
vaccination démontrés qui fut vivement critiqué par le Comité
central de vaccination chargé de suivre la campagne initiée par
l'Empereur. D'autres livres circulèrent: hostiles à la vaccination, ils
propagèrent la peur que l'homme puisse être contaminé par des maladies
animales.
Article publié par le journal Le Monde en 2012

Les
efforts de l'administration napoléonienne furent fructueux :
dès le début du XIXème siècle la
mortalité variolique chuta de 10% à 1%, la
dernière épidémie de variole en France eut lieu
à Vannes en 1954 avec 16 morts pour 73 cas connus ( Le sergent Roger Debuigny
qui rendait
visite à sa famille dans le Morbihan, avait apporté avec lui de
la
soie de
Saigon qui aurait
été contaminée).
Le Comité Central de
la Vaccine crée en 1803 et rattaché à l'Académie
de Médecine en 1820 ordonne les campagnes de vaccination. La
circulaire du 26/08/1880 réserve l'acte vaccinal aux seuls
diplômés ( jusqu'alors les prêtres, religieuses, notables, instituteurs
... avaient prêté leur concours ). La vaccination de bras à
bras restera la plus répandue jusque dans les années 1880. Les
autorités se plaignent du faible nombre d'enfants vaccinifères
- on récoltait sur leurs pustules la pulpe vaccinale servant aux
vaccinations - imputé à l'opposition des familles .Cet obstacle
disparaîtra dans la dernière décennie du siècle suite à l'adoption
d'abord de la "vaccine animale" puis du procédé de
conservation de la pulpe vaccinale qui permettra de s'affranchir
de la présence de génisses lors des séances de vaccination. Si
les vaccinations sont souvent dispensées gratuitement aux
indigents , il s'en faut de beaucoup que la gratuité soit
largement pratiquée. La création d'un service public de
vaccination fait l'objet de débats dans lesquels le statut
libéral de la médecine pèse d'un poids certain . De nombreuses
voix appellent à une obligation vaccinale, seule capable de
venir à bout de populations rétives et peu accessibles à
quelque éducation sanitaire que ce soit. Dans les colonies cette
obligation fut instituée plus tôt qu'en Métropole, ainsi en
1876 en Cochinchine. En 1843, 1858,1880 plusieurs projets de loi
ayant en vue une obligation vaccinale échouent.
Le 15 février 1902 ,la loi sur
la Protection de la Santé publique, en son article 6, rend la
vaccination anti-variolique obligatoire au cours de la première
année de vie ainsi que les revaccinations des dixième et
vingt-et-unième
années.
La vaccination n'est plus obligatoire en France depuis 1979, et les rappels ne sont plus
obligatoires depuis 1984.
A Bordeaux
Les années 1870-1871 ont
été marquées par un accident profond dans la croissance
démographique de la ville...La guerre a sans doute arrêté
l'immigration,
et une épidémie de variole a entraîné une surmortalité très
importante : 8213 décès en 1870 pour 4000 environ dans les
années normales. Cette épidémie n'est pas liée à la guerre;
elle a commencé en 1870 dès le début du printemps."
Bordeaux au XIXème siècle,
Charles Higounet, 1969, page 239.
Remarque : Le tableau de
mortalité épidémique pour Bordeaux, présenté en haut de page, donne les
relevés de 1882 à 1891.
Le service municipal de vaccination a été organisé pour
combattre une épidémie de variole qui a frappé Bordeaux en 1881.
Auparavant, la maladie frappait tous les trois ou quatre ans. En 1870,
le nombre des décès atteint 2070 pour une population de 192000
habitants ( 1077 décès pour 100000 habitants). En 1871, on compte
encore 471 décès causés par la variole mais la maladie disparaît
presque totalement en 1872 1873, 1874 et 1875). Le réveil épidémique se
fait en 1876, et les années 1877 et 1878 connaissent un taux de
mortalité de 122 et 144 pour 100000 habitants. En 1879, la mortalité
tombe à 6 décès pour 100000 habitants, se relève en 1880 (44
décès pour 100000 habitants) et atteindra en 1881 le taux de 198 décès
pour 100000 habitants.
Chaque fois que la maladie frappait, l'administration
municipale organisait un service spécial de vaccination de bras à bras,
avec du vaccin humain, dans des maisons signalées à la population. Mais
la procédure bras à bras soulevait de fortes réticences et les efforts
de la municipalité restaient inefficaces. L'épidémis suivait son cours
naturel et s'éteignait d'elle-même.
En 1881, pour combattre l'épidémie, la municipalité adopta le
vaccin de génisse que l'on pouvait obtenir en grande quantité et qui en
outre, avait l'avantage de ne pas soulever les répugnances ou les
craintes du vaccin humain. Cette innovation permit de pratiquer, en
très peu de temps, un nombre très important de vaccinations. En outre,
l'isolement des malades et la désinfection des linges et des locaux
contaminés contribuèrent à faire disparaître l'épidémie de 1881 très
rapidement.
Mais, une faille subsistait : lorsque l'épidémie était
maîtrisée le système mis en place était abandonné. La population
n'était pas protégée contre une nouvelle épidémie de variole importée
par la voie maritime. Il manquait donc une préservation
permanente de la population.
C'est l'adoption du vaccin de génisse qui transforma la lutte
contre la variole. Dès qu'une épidémie se déclarait, on transportait
immédiatement une génisse dans le quartier concerné pour procéder à la
vaccination des habitants. Le service municipal bordelais a même envoyé
ses génisses dans certaines communes de la banlieue.
A partir de 1881, l'action mise en place porta ses fruits :
en 1882, 34 décès pour 100000 habitants. Le tableau en haut de page
montre que, à la fin du XIXème siècle, la mortalité due à la variole
était en voie de disparition.
A Bouliac
Le 26 juin 1830, le
maire
écrivait, dans une lettre au préfet, "il paraît que les
officiers de santé de mon voisinage s'occupent peu de pratiquer
cette utile découverte à laquelle je le dis à regret les
habitants des campagnes répugnent d'exposer leurs enfants."
Le 30 octobre
1838, l'état des vaccinations,
opérées en 1837, mentionne 11 vaccinations pour 14 naissances
et aucun bouliacais atteint de la petite vérole. Le médecin
vaccinateur était M. Soules de Latresne.
Le 28 février 1839,
les archives du conseil municipal nous
apprennent que les vaccinations de 1838 concernaient 21
naissances et ont donné lieu à 15 vaccinations. Aucun sujet n'était
atteint de la variole en 1838. Les médecins vaccinateurs
étaient MM. Soules et Lacoste.
Prévoyance et mutualité
Elle existe à Bouliac depuis la fin du XIXème siècle.
La Revue de la prévoyance et de la mutualié (1905), dans sa
rubrique des distinctions honorifiques décernées aux sociétés de
secours mutuels, fait savoir que M. Crémier a
reçu la médaille de bronze.
M. Crémier était le père du forgeron qui exerçait encore en 1960;
En janvier 1926, La Revue Philantropique
(n°341) signale que la consultation des nourrissons municipale de
Bouliac a reçu une subvention de 120 francs (Subventions aux Oeuvres
d'Assistance maternelle).
Le
choléra
Maladie
transmissible, endémo-épidémique, le choléra est strictement
limité à l'espèce humaine : il est provoqué par des
bactéries du genre Vibrio et n'a rien à voir avec certaines
infections animales comme le choléra des poules (causé par des
Pasteurella). Originaire d'Asie où il existait depuis des temps
immémoriaux, le choléra a connu plusieurs extensions
meurtrières en Europe, Amérique et Afrique à partir du
XIXe siècle.
Depuis 1960, la maladie a pris une allure bactériologique et
épidémiologique nouvelle, au point que l'on doit opposer
désormais un choléra « actuel » au choléra
asiatique « classique ».
Les grandes épidémies
cholériques
Le choléra, dont le lieu d'origine peut
être situé au Bengale, n'a cessé de sévir de façon
endémique dans le delta du Gange, avec des diffusions plus ou
moins étendues au reste de la péninsule indienne. Durant des
siècles, ses expansions périodiques restèrent limitées à l'Asie
du Sud-Est. À partir du début du XIXe siècle, les
progrès des échanges commerciaux et de la navigation
contribuèrent à sa dissémination, à l'est vers la Chine et le
Japon, à l'ouest vers l'Afghanistan, l'Iran, la Syrie, l'Égypte
et le bassin méditerranéen. L'année 1817 ouvrit la première
des six « pandémies » durant lesquelles le choléra
déferla sur le monde : de 1817 à 1823, l'Asie entière fut
atteinte et l'épidémie s'étendit jusqu'à la côte orientale
de l'Afrique. Les frontières de l'Europe furent atteintes pour
la première fois en 1823 à partir de l'Asie Mineure ; la
Russie, l'Allemagne, l'Angleterre, la France et finalement
l'Europe
dans son ensemble totalisèrent plus d'un
million de victimes
jusqu'en 1837 ;
simultanément, le choléra atteignit toute
l'Amérique du Nord et l'Australie. La troisième pandémie
ravagea l'Europe et le bassin méditerranéen de 1846 à 1851
avant de gagner à nouveau l'Amérique du Nord. De 1863 à 1876,
le choléra toucha à nouveau l'Europe, mais surtout se répandit,
à partir du bassin méditerranéen, en Afrique jusqu'au
Sénégal et en Amérique du Sud (république Argentine). C'est
à l'occasion de l'épidémie qui frappa l'Égypte, une fois
encore, en 1883, que Robert Koch découvrit le germe responsable :
Vibrio cholerae. Une prophylaxie rationnelle put alors voir le
jour. Elle n'empêcha pas la Russie et l'Europe centrale d'être
atteintes à nouveau de 1892 à 1896 et même, plus tardivement,
en 1902, en 1908, puis lors de la guerre des Balkans et lors de
la Première Guerre mondiale. Cependant, les mesures
prophylactiques finirent par porter leurs fruits ; ainsi la
Seconde Guerre mondiale, malgré l'importance du brassage des
populations, n'entraîna pas de nouvelle extension. Peu à peu,
de 1910 à 1960, le choléra en vint à se cantonner dans ses
zones endémiques d'origine et les épidémies demeurèrent
toujours centrées sur le delta du Gange, avec des fluctuations
en fonction des circonstances locales et des mesures
prophylactiques. Ainsi l'activité incessante des instituts
Pasteur d'Indochine contribua largement à la réduction du foyer
de Cochinchine. D'autres circonstances favorisèrent la
régression en d'autres points : les foyers de la Chine
méridionale par exemple s'éteignirent grâce au blocus des
guerres sino-japonaises.
© Encyclopædia Universalis 2006, tous droits réservés
A Bordeaux
... depuis
l'apparition du
choléra en Europe , le trafic maritime véhiculait l'épidémie...
Trois hôpitaux spéciaux doivent être aménagés pour les
cholériques...les premiers cas de l'épidémie apparurent au
début du mois d'août ; l'épidémie se développe surtout du 20
août au 25 septembre. Sur 341 cas déclarés, il y eut 275
décès, principalement parmi les gens de plus de 50 ans...si l'année
1849 a connu le choléra, qui a provoqué un excédent de 173
décès...Entre 1846 et 1851, la population de Bordeaux...malgré
le choléra, passe de 125 320 habitants à 130 911...La
mortalité bordelaise est irrégulière et reste marquée par des
pointes épidémiques, de choléra notamment, jusqu'en 1855.
Bordeaux au XIXème siècle,
Charles Higounet, 1969, pages 66, 67, 174, 239.
A Bouliac : plus de peur que de mal !
En mai 1832, le conseil
municipal enregistre la possibilité "d'apparition du
choléra" et la nécessité de secourir les indigents ; il
vote une somme de 309 f 46 c "destinée à secourir au
besoin les indigents de la commune atteint de cette maladie."
Fort heureusement, cette provision ne fut pas utilisée.
Le 15 juin 1836, le conseil décida le
recurement des jalles et
fossés de la Pallus "pour éviter des maladies contagieuses."
| L'ordonnance
du 27 mai 1845 interdit la circulation des chiens non
muselés, fait obligation du port d'un collier avec une plaque indiquant
le nom et l'adresse du maître. Les entrepreneurs et conducteurs de
voitures publiques ne doivent pas conduire des chiens non muselés Les
marchands forains, industriels, voituriers doivent les tenir attachés
très court avec une chaîne de fer, sous l'essieu de leur voiture.
Défense est faite d'attacher des chiens aux voitures à bras. Les chiens
bouledogues, considérés comme très dangereux, ne peuvent être conduits
sur la voie publique, même en laisse et muselés.En cas de morsure d'un
chien présumé enragé, on appliquera les mesures affichées dans tous les
postes de police.
La loi du 2 mai 1855 a établi sur les chiens une taxe dont le
produit aidera dans l'exécution de travaux municipaux. Cette taxe
ne peut excéder 10 fr ni être inférieure à 1 fr. Chaque conseil
municipal dresse un tarif soumis à l'approbation du conseil général.
Les tarifs ne comprennent que deux taxes : la plus élevée pour les
chiens d'agrément ou servant à la chasse, la moins élevée pour les
chiens de garde. Du 1er octobre de chaque année au 15 janvier de
l'année suivant, tous ceux qui possèdent des chiens sont tenus de faire
une déclaration en mairie indiquant le nombre de leurs chiens et leurs
usages. Ces déclarations sont enregistrées sur un registre spécial tenu
par le maire.
A Bouliac
Le
conseil municipal a connu la loi du 2 mai 1855 au cours de sa
séance du 23
août 1855 et
après avoir délibéré a voté le tarif suivant:
"première classe comprenant les chiens de luxe et de
chasse 8 francs
seconde
classe - chiens de garde
-
3 francs"
|
La rage
Délire furieux, revenant
par accès, généralement accompagné d'horreur pour les liquides et
d'envie de mordre...
La rage est une maladie, particulière aux animaux du genre chien
et chat et contagieuse à l'homme...Son histoire est très-obscure. Elle
paraît cependant avoir été connue de très-bonne heure chez les
Grecs car on a cru en retrouver, des traces dans les écrits
d'Homère et de Xénophon. Hippocrate n'en parle que d'une manière vague.
Aristote, au contraire, la signale avec précision. Mais il faut arriver
à Ceïse pour en trouver une description détaillée et surtout l'opinion
de sa transmissibilité du chien à l'homme, dont les anciens paraissent
n'avoir eu aucune
notion. L'histoire retrace les nombreux ravages qu'elle a exercés à
diverses époques en Europe.
Grand dictionnaire universel du
XIXème siècle, Pierre Larousse, 1866-1877.
En
France, les mesures de police pour préserver des atteintes des animaux
enragés ont été mises en place par l'ordonnance du 27 mai 1845 : elle
obligeait à museler les chiens. De 1845 à 1853, 378 chiens enragés ont
été amenés à l'Ecole vétérinaire. En 1854, après l'entrée en vigueur,
le nombre de chiens enragés recueillis à l' Ecole Vétérinaire fut de 4
; en 1855, il y eut 1 chien ; en 1856, également 1 chien ; de 1857 à
1861 : 0 chien.
Ces nombres montrent l'efficacité de l'ordonnance de 1854.
La rage est une maladie presque constamment
mortelle chez l'homme lorsqu'apparaissent les premiers signes. Les cas
de survie sont tout à fait exceptionnels. En revanche, la vaccination
antirabique pratiquée entre la contamination et l'apparition des
premiers signes est très efficace. Le vaccin a été expérimenté en 1885
par Louis Pasteur sur Joseph Meister, un jeune garçon mordu par un
chien enragé sur le chemin de l'école à Meissengott en Alsace, en
Alsace. Le maître du chien, Théodore Vonné, avait alors abattu la bête
puis mené l'enfant chez le docteur Weber de Villé.
Extrait de Wikipedia
|

|
La rage a-t-elle frappé à
Bouliac ?
Le chien du cultivateur Biguey
a été atteint et a mordu plusieurs animaux en différents endroits de la
commune. Le maire a estimé que l'animal a été trop
tardivement abattu par son maître et que par conséquent "la sûreté
publique exige impérieusement de ne rien négliger de ce que la prudence
peut suggérer ... considérant que la saison des fortes chaleurs
approche ce qui multiplie habituellement les cas d'hydrophobie
parmi les chiens, et qu'il importe de faire exercer une active
surveillance de ces animaux pour prévenir de déplorables accidents
qu'ils pourraient causer ..." Il a donc décidé que tous les chiens de
la commune seraient muselés, qu'il serait interdit de les encourager à
se battre et qu'ils seraient enchaînés à la charrette de leur maître.
|
|
Les
chiens déclarés de la commune
Le relevé le plus ancien concerne la période
1835/1836 : 30
chiens sonrt enregistrés.
En 1872, la
liste des possesseurs de chiens de garde et de chasse comporte 61
propriétaires avec 65 chiens de garde et 12 chiens de chasse.
En 1873, on
relève 65 propriétaires de chiens avec 64 chiens de garde et 13 de
chasse.
En 1877, 76
propriétaires avec 71 chiens de garde et 20 chiens de chasse.
Joachim Touchard, curé de
Tabanac, propriétaire de la maison Vettiner, a déclaré un chien de
garde.
En 1878, 81
propriétaires avec 81 chiens de garde et 19 chiens de chasse
En 1883, 68
propriétaires avec 61 chiens de garde et 21 chiens de chasse.
E
Chiens agressifs et abandonnés
Le
26 août 1829,
l'homme
d'affaires de M. Meslan Laville est mordu par un chien.
Le 12 juin 1838,
Catherine Moulon a
déclaré que "vers une heure du matin étant assise sur la borne de la
grange de Monsieur Vigneral bordant le chemin de servitude attendant
l'arrivée de sa voisine Jeanne Cornet pour s'acheminer à Bordeaux pour
la vente des fruits, le chien de Madame Vve Labariere, propriétaire ...
s'est précipité à l'improviste sur la femme Fradin, l'a renversée,
déchiré ses vêtements et une morsure à l'épaule droite qui à la vérité
n'est pas dangereuse".
Remarque
: On partait à une heure du matin, vraisemblablement à pied, pour aller
vendre des fruits à Bordeaux !
Le 1er octobre 1872,
M. Campagne déclare avoir trouvé sur le ponton des bâteaux à vapeur,
aux Collines, un chien abandonné.
|
C'était à
Bouliac, peut-être !
En hiver
1731, près de Bordeaux, 4 hommes furent attaqués : 1 seul survécut.
|
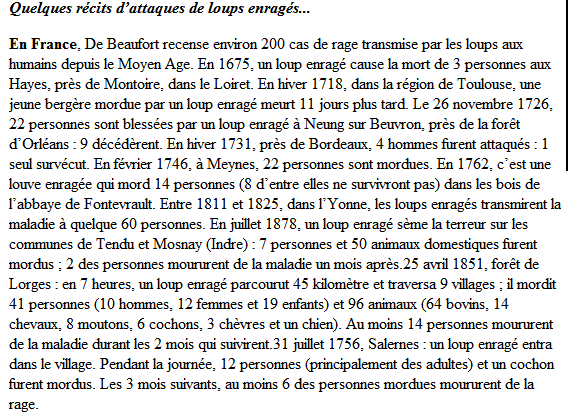
|
Et la
phitsie ?
De nos jours appelée
tuberculose, elle a fait à Bordeaux 133 victimes en 1891. Maladie
redoutée, car sans remède connu à la fin du 19ème siècle, elle
sévissait également à Bouliac. Un jeune habitant de la commune fut
soigné par le médecin Eugène Vovard par un curieux traitement.
Texte extrait de De
l'emploi du sang comme agent reconstituant dans la phitsie pulmonaire,
publié en 1865, consultable à la Bibliothèque Nationale de France
(Site Gallica)
Les chiens, les vaches, les cochons ... et même les ours à Bouliac !
|
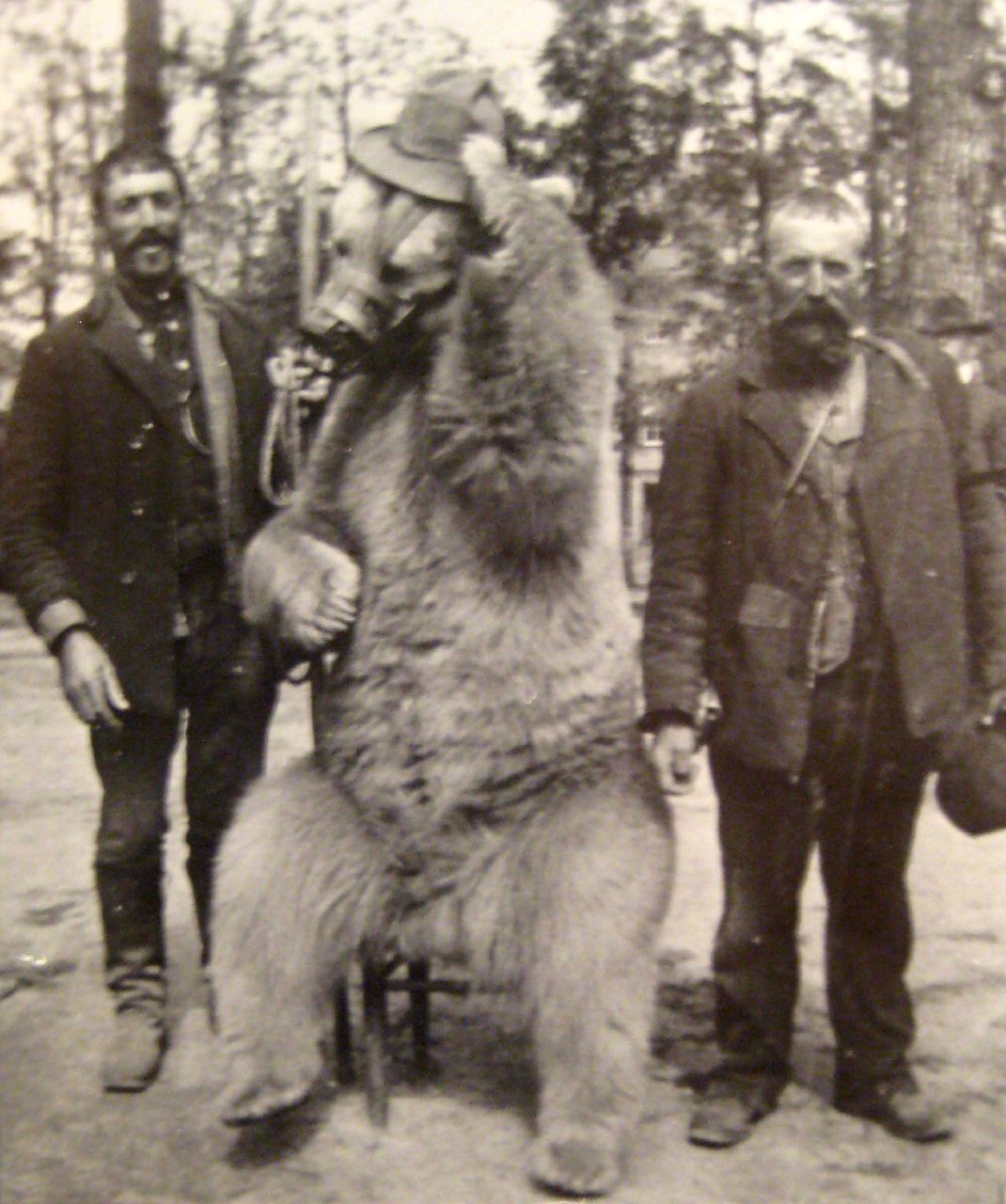
|
Des ours à Bouliac ?
Oui, vous avez bien lu
! M. de Buhan, conseiller municipal, les a vus. Le 13 août 1887, il a prié le maire
d'écrire au préfet pour lui demander de décider l'interdiction de
séjour d'une bande de bohémiens établis sur le chemin de Vimeney, entre
Floirac et Bouliac, "avec une quantité d'ours, un de ces animaux même
s'est échappé mais a été repris, ces animaux effraient les chevaux et
peuvent occasionner des accidents. Monsieur le maire de Bordeaux a
interdit le séjour sur le territoire de Bordeaux de ces caravanes
il ne comprend pas que le maire de Bordeaux ne les recevant pas les
communes environnantes qui ont moins que la ville de Bordeaux, des
moyens de surveillance, soient obligées de les recevoir."
|
La lutte
contre la divagation des animaux malfaisants ou furieux" est très
ancienne à Bouliac. On trouve dans les archives communales un arrêté du
2 mai 1844 qui précise que
"pendant la durée des chaleurs il y a danger de laisser sortir et
divaguer les chiens non muselés" et que "déjà plusieurs accidents
sont survenus par suite de la négligence des propriétaires à tenir
leurs chiens à l'attache non muselés." Pour lutter contre ces dangers
le conseil décide une campagne d'empoisonnement des chiens errants, à
partir du 6 mai jusqu'au 1er novembre : "il sera jeté dans les places
publiques et chemins des viandes empoisonnées" et que "Si un chien est
est réputé méchant ou soupçonné d'avoir été mordu par un autre chien
enragé, il sera tenu à l'attache et tous ceux qui seront trouvés en
divagation dans les chemins et champs seront abattus ou empoisonnés."
Le
25 février
1847
arrête: "Tout
habitant de la commune possédant des chiens devra les tenir enfermés et
attachés jusqu'à nouvel ordre. tout chien errant pourra être tué par le
garde champêtre..."
En
1853, le maire ,dans un
arrêté, souligne "que la saison des fortes chaleurs approche, ce
qui (?) habituellement les cas d'hydrophobie parmi les
chiens, et qu'il importe de faire exercer une active surveillance de
ces animaux, pour prévenir de déplorables accidents qu'ils pourraient
causer."
Le 13 août 1876
Les chiens non muselés risquent la mort !
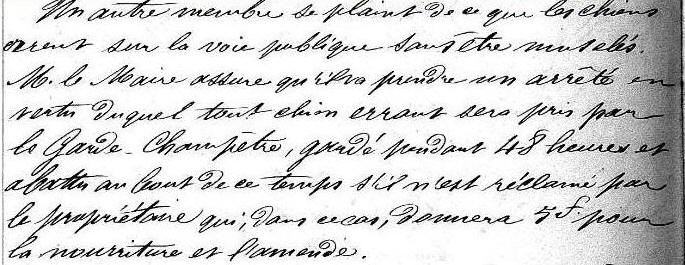
|

|
La commune devait
également lutter contre les animaux qui dégradaient les chemins. Ainsi, le 11 mai 1851, le conseil prend
"connaissance de diverses plaintes au sujet des dégâts qui sont
journellement occasionnés par des troupeaux de bêtes à cornes conduites
par des individus étrangers à la commune qui les laissent pâturer dans
les chemins" et "invite M. le maire à faire exécuter ponctuellement la
loi qui interdit la dépaissance sur la voie publique."
Le 8 juillet 1883, M. de Buhan "se plaint
amèrement de ce que les bestiaux séjournent très longtemps sur les
chemins de la commune et sur le chemin de halage du Bord de l'eau, les
propriétaires font pacager leurs bestiaux qui abîment tous les
accotements, les font tomber, il prie monsieur le Maire de vouloir bien
donner des ordres au garde champêtre pour verbaliser contre les
propriétaires de ces troupeaux de bestiaux qui doivent passer sur les
chemins mais non y séjourner."
|
En 1905, La Revue philomatique de
Bordeaux et du Sud-Ouest, (volume 8, page 80) indique que Bouliac
compte 44 vaches.
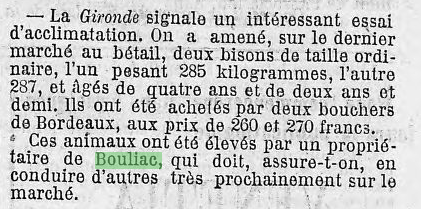 |
Le Globe (volumes 37 à 38, page 126)
nous apprend que "... en 1876, on avait amené au marché de Bordeaux
deux bisons gras, âgés de 4 et 2 1/2 ans, élevés par un propriétaire de
Bouliac qui avait encore d'autres animaux pareils à vendre aux bouchers
(Journal Officiel, 10 novembre 1876)." |
Les chevaux et leurs
voitures
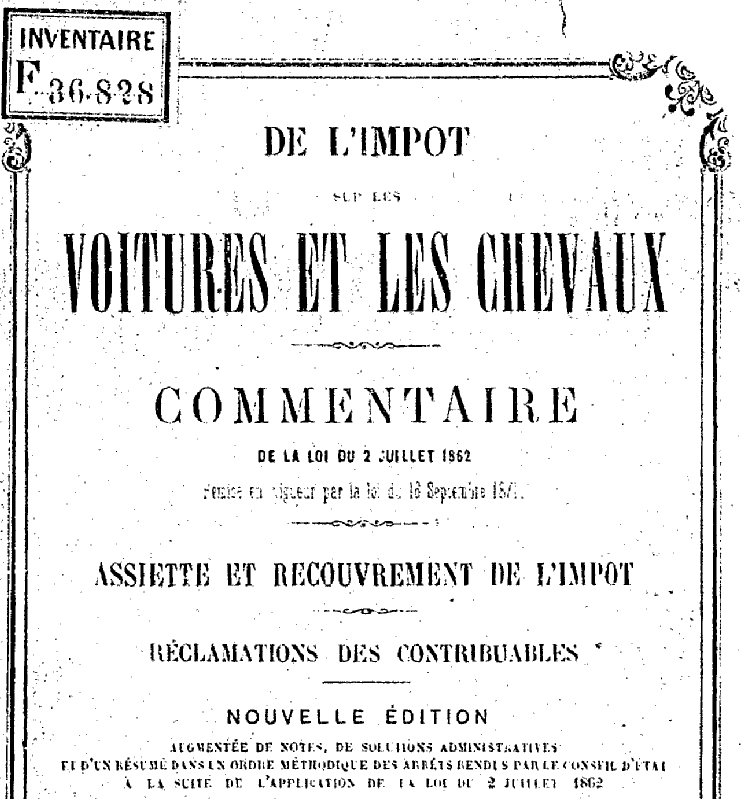
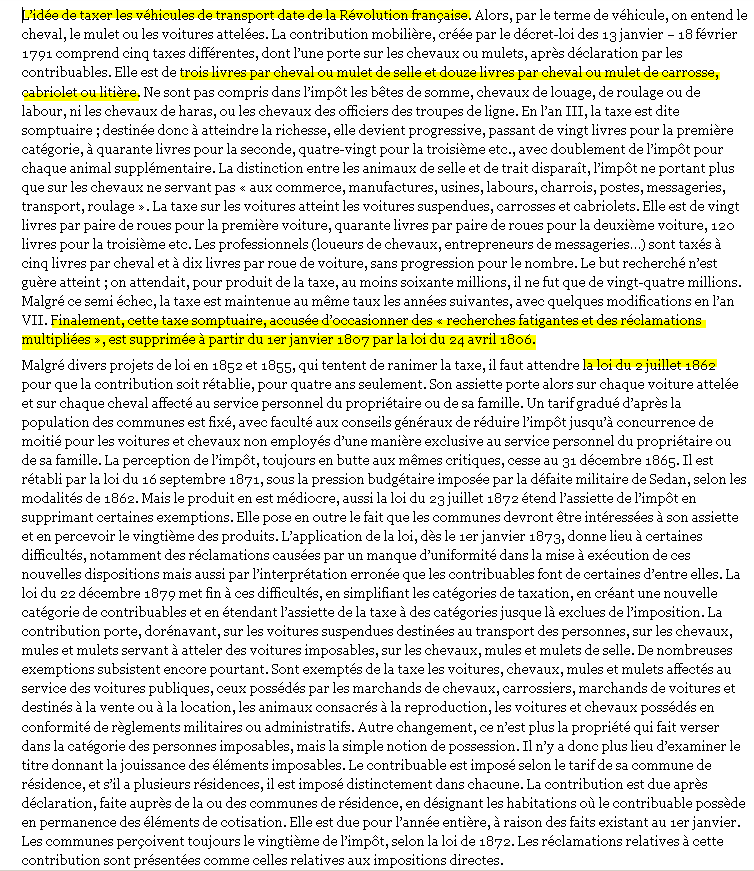


Les jardinières étaient tirées par un
ou deux chevaux...ou par un âne
Année 1872
Ont
déclaré M. Chalès : 1
voiture à 4 roues et 1 cheval
M. Bouluguet : 1 voiture à 2 roues
Mme Veuve Sussac : 1 voiture à 4 roues
M. Hervouet : 1 voiture à 4 roues et 1 cheval
M. Gardère: 1 voiture à 4 roues et 1 cheval
M. Jurine : 1 voiture à 4 roues et 2 chevaux
M. Giard : 2 voitures chacune à 4 roues et 1 cheval
Année 1873
Neuf noms
sont ajoutés à la liste des chevaux de 1872 et 13 noms pour les
voitures dont celui de M. Baudet débitant au Marais ( l'auberge et
épicerie) et de M. Serre, menuisier, propriétaire d'une "carriole
suspendue pour le service de son industrie".
Année 1876
M. Girard a
déclaré 1 voiture à 4 roues.
Année 1878
M. Deffès a déclaré 4 chevaux de luxe, un vis à vis à 4
roues, un omnibus à 4 roues et un panier-duc à 4 roues.
Voiture vis à vis à 4
roues
Voiture omnibus à 4
roues
Voiture vis à vis à 4 roues
M.
Abria déclare une petite charrette suspendue attelée par une anesse et
M. Moucade une petite charrette suspendue attelée par un petit âne.
M. de Buhan se déclare propriétaire d'un cheval de selle.
Année 1879
La liste
s'est considérablement allongée.
Ont
déclaré M.
Raoux
1 voiture suspendue
M.
Giard
1 voiture suspendue (jardinière) à 1 cheval pour le
service des domestiques et des paysans et le transport des
légumes à Bordeaux.
M. Des Moulins 1
voiture à un cheval(jardinière)
M.
Degans
1 jardinière pour le service de la propriété et de
son épicerie.
M. Arnaud Jean 1
jardinière, au Marais
M.
Avensail
1 jardinière servant à transporter le lait à
Bordeaux
M. Brisson Jean 1
jardinière
M.
Serre
1 voiture à cheval(jardinière) servant à son
industrie
M. Panchaud Bernard 2 carioles à cheval pour porter le pain
M.
Daviaud
2 voitures à 4 roues et 1 cheval servant au labour et aux dites
voitures
MM. Badé et frères 1
voiture à 2 roues et 3 chevaux pour leurs charrettes
M.
Cazaux
1 voiture et un cheval servant pour cette voiture (marchand
épicier)
Année 1893
Une note de
juin 1893 indique qu'il n'y a pas de voitures à 4 roues au Dragon mais
bien 2 voitures à 4 roues. Ces 2 voitures sont la propriété de Mme Vve
Herman Cruse, les deux chevaux seuls sont à porter sur l'avertissement
de M. Frédéric Cruse.
Année 1894
M. Mercier (propriété de M. A. Rodel) déclare un cheval et une
voiture à deux roues.

Façade

Façade Ouest

Le puits

Puits et ruches

Nouvelle pompe

ancienne pompe

Citerne

Le chai