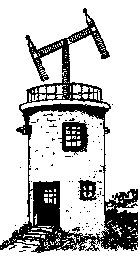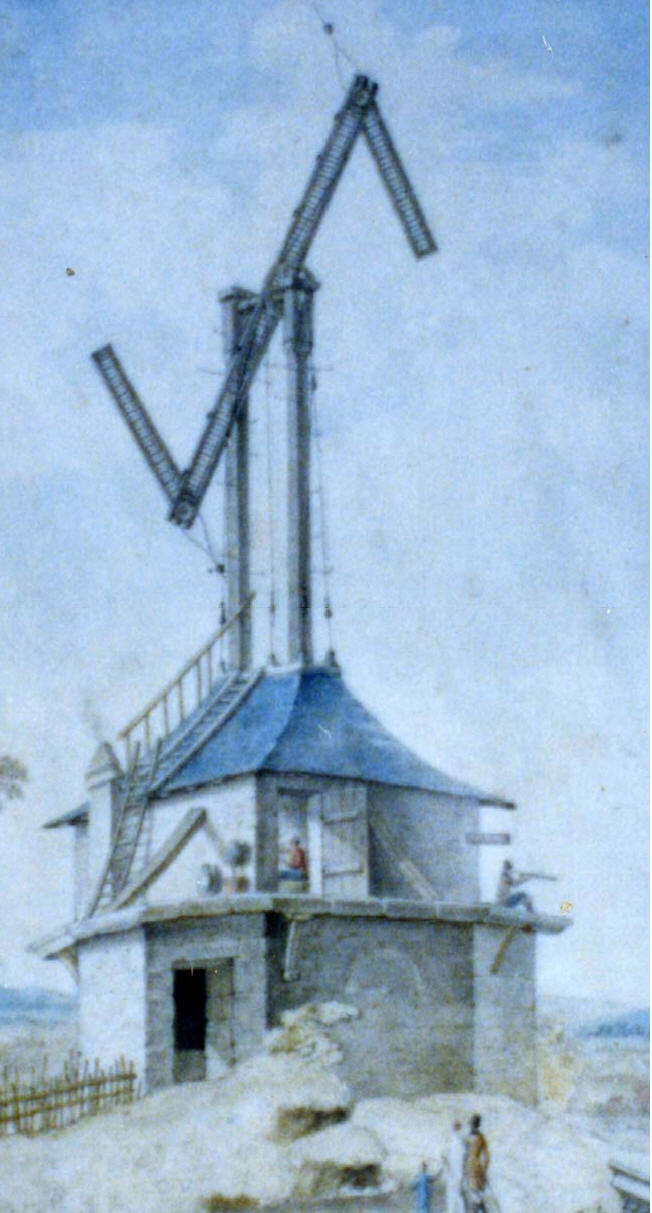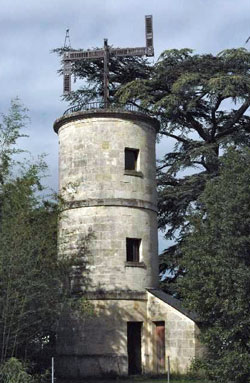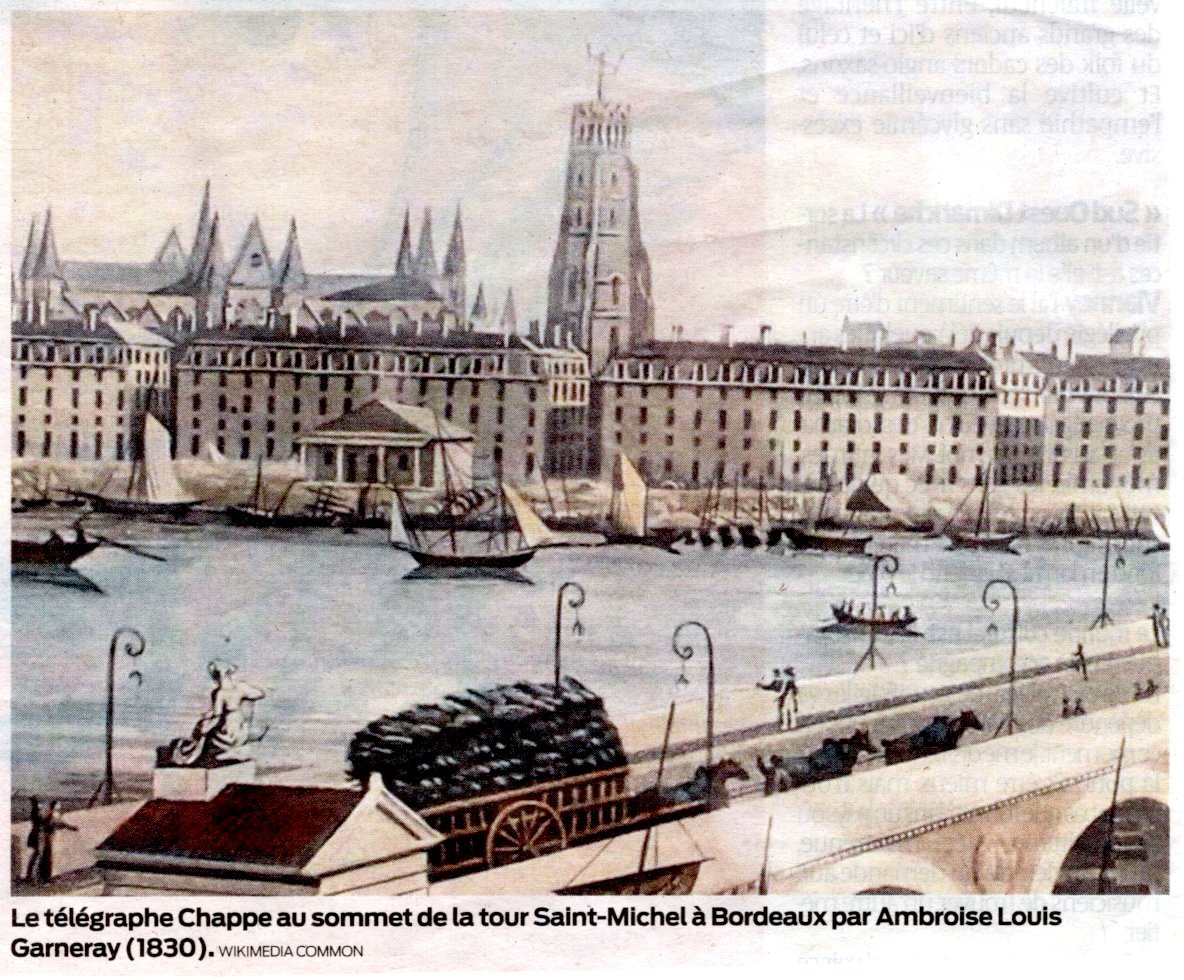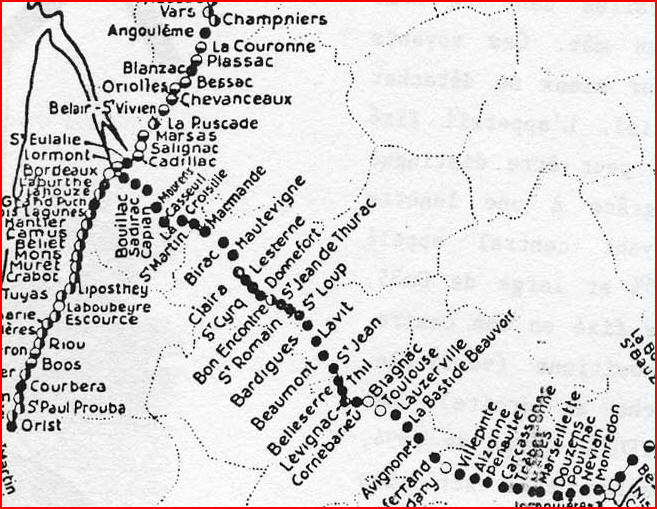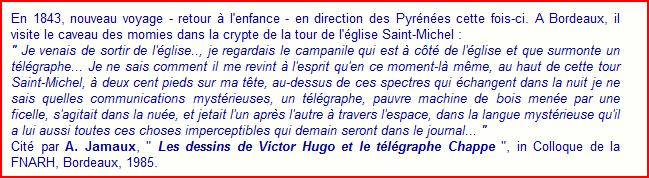Le
télégraphe optique de Chappe à Bouliac
et le télégraphe municipal
***
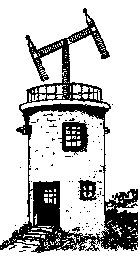 |
Rappels
historiques
Il y a bien longtemps on peut
imaginer que les hommes communiquaient à distance en poussant des cris,
moyen limité à la portée de la voix humaine, quelques dizaines de mètres !
Plus tard, avec l'écriture, les messages ont pu franchir de longues
distances grâce au cheval, mais au prix de délais considérables : on sait,
par exemple, que la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789 ne fut connue à
Bordeaux que le 17 par une lettre de Paul Nairac, membre de la Constituante
! Vers 1790, une
diligence pouvait porter un message de Paris à Strasbourg en quatre
jours. En 1799, le même message mettra moins de ...2 heures
!
En 1791, un progrès remarquable fut réalisé. On le doit à Claude Chappe et à
ses frères qui ont inventé le premier télégraphe aérien et optique, le
premier système de télécommunication au monde. Et Bouliac fut, jusqu'en
1855, un maillon de ce système !
Claude
Chappe, dit Chappe de Vert,
est né en 1763, deuxième enfant d'une famille de cinq frères. Après de
solides études, il jouit de rentes qui lui permettent d'ouvrir un cabinet de
physique à Paris.
A la Révolution, il poursuit ses expériences et
grâce à son frère
Ignace, membre de l'Assemblée Législative, il réussit à faire adopter son
invention de télégraphe aérien et il est chargé de construire une première
ligne de Paris à Lille. Elle sera opérationnelle en 1794. D'autres lignes
suivront, mais faute de crédits les lignes seront mises en sommeil ou
même fermées par Bonaparte fin 1800 .
Pour
sauver le télégraphe, Claude Chappe cherche d'autres ressources. A cause des
incertitudes militaires, de nouvelles études sont relancées, mais affaibli
physiquement et moralement par 10 ans de recherches et de luttes, Claude
Chappe se donnera finalement la mort, à Paris, en 1805, à l'âge de 42 ans.
Après la mort de
Claude Chappe, ses quatre frères, notamment Abraham dit Chappe Chaumont,
poursuivront son œuvre pendant plus de 25 ans. Sans eux, l'aventure du
télégraphe qui dura un demi-siècle, de la Révolution à Napoléon III, pendant
la période la plus agitée de l'histoire de notre pays, n'aurait pu avoir
lieu. A eux quatre, ils ont construit le télégraphe optique de Chappe qui, à
son apogée, comptait 553 stations (dont celle de Bouliac) reliant 29 villes,
réparties sur une longueur de 5 000 kilomètres.
La Convention, le 4 août 1793,
décrète la création de la première ligne de télégraphe entre
Paris et Lille. La
réussite de la ligne de Paris-Lille permettra d'envisager la création des
lignes suivantes. |
La
technique
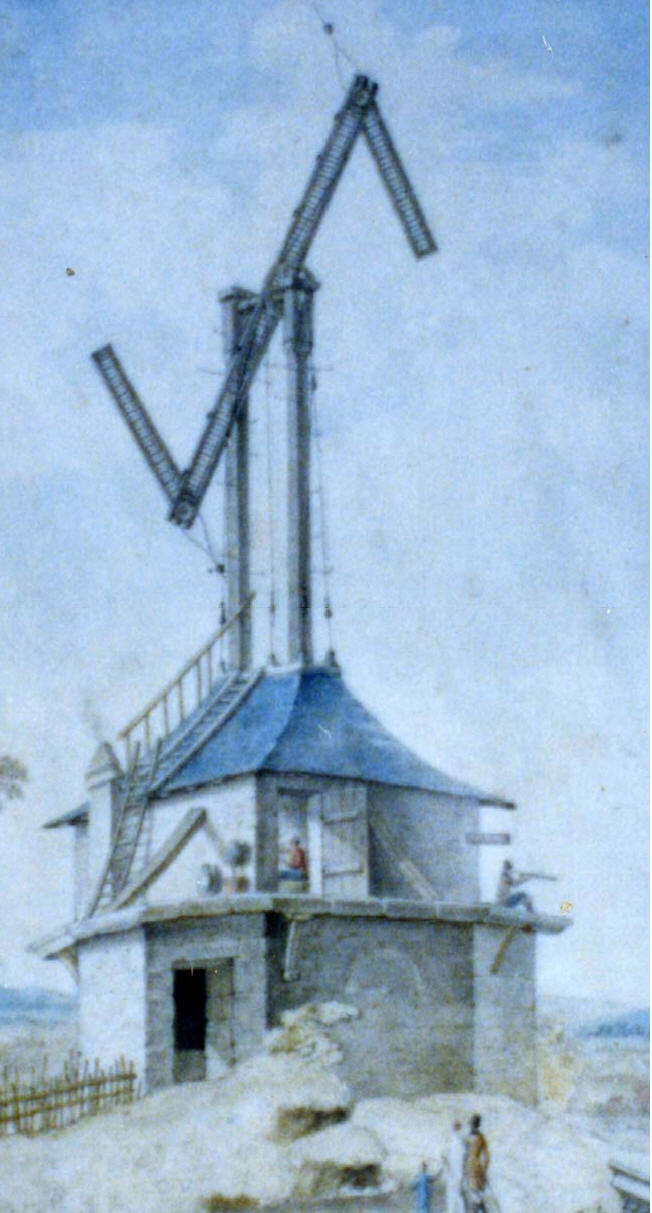 |
Le télégraphe
optique met en jeu un mécanisme aérien visible de loin, deux lunettes
et l'utilisation d'un code de transmission.
Comme il doit être visible de loin, le télégraphe est placé sur une
hauteur : montagne, colline, ou monument existant tel que clocher d' église,
tourelle de château,... Quand ce n'est pas possible, on le place sur le toit d'
une construction en bois ou sur une tour, carrée ou ronde, sans tenir compte de
l'esthétique : devant l'urgence de la situation, le bois a été le matériau le
plus employé, remplacé par la suite par des constructions en pierres. L'appareil
définitif et complet (représenté ci-contre), appelé poste ou station, comprend
deux parties : une partie visible de loin, et une partie abritée. Cette dernière
est elle-même divisée en deux pièces : l'une d'elle sert à la manipulation des
bras du télégraphe et l'autre de salle de repos aux stationnaires.
La partie mécanique
du télégraphe est constituée
d'un certain nombre de pièces de bois dont les parties les plus fragiles sont en
persiennes afin d'offrir moins de prise au vent.
Les pièces mobiles et le système de commandes sont reliés par des cordages
tendus par des ressorts. Les axes sont en cuivre. Chaque station est éloignée
d'une dizaine de km de sa voisine.
Sur l'image, on
perçoit l'observateur avec une lunette lui permettant de lire la
position des bras de la station voisine et le manipulateur qui reproduit les
signaux que lui dicte l'observateur.
Les télégraphistes ignoraient
totalement la signification du message transmis. Seuls, en bout de ligne, l'
émetteur et le destinataire en avait connaissance. Le directeur de la
station terminale reconstituait la signification du message émis en
utilisant le vocabulaire de traduction des signaux reçus, soigneusement
protégé dans un coffre. |
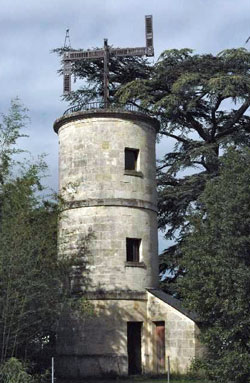 |
En 1834, est créée la ligne du Midi qui
relie Bordeaux et Narbonne. En 1840, elle sera prolongée jusqu'à Perpignan
et Avignon. La station émettrice est portée par la tour de
l'église Saint-Michel. Le premier relais de cette ligne est placé sur la
place Chevelaure qui donne une visibilité parfaite sur Saint-Michel (le jour
et par temps clair !). Le relais suivant est situé à Sadirac.
Le premier télégraphiste de Bouliac fut
Antoine Cazaux. C'est le premier "télégraphier" de notre commune !
Sur cette ligne, il y avait en Gironde, 7 stations ayant chacune 2
télégraphiers ( sauf Bordeaux qui en comptait 4).
Les deux derniers télégraphiers, en avril
1853 étaient : Cazaux et Reaux.
Fin 1844, commencent les travaux de la
première ligne télégraphique électrique Paris-Rouen qui marque le début du
démantèlement du télégraphe optique, ligne après ligne. La tour de Bouliac a
disparu en 1855 après l'abandon de cette ligne en avril 1853. "... le
prix de la vente fut consacré à la plantation des ormes que nous voyons
aujourd'hui.
La
place Chevelaure et le télégraphe optique vus par l'abbé Pareau
"Sur cette place s'élevait la tour d'un télégraphe aérien. Le premier
télégraphiste de Bouliac fut M. Ant. Cazeau, dont la fille, Mme Herminie
Bouluguet, habite le village.
La
tour fut démolie en 1855, et le prix de la vente des matériaux fut consacré
à la plantation des ormes que nous voyons aujourd'hui.
Pour
assurer sans frais aux arbrisseaux la culture et le gardiennage
nécessaires, la municipalité afferma la place, avec cette condition que les
tendres ormilles seraient l'objet, en temps opportun, des soins voulus, que
même on ne sèmerait ou planterait les légumes qu'à une distance déterminée
de leurs frêles racines. L'heureux fermier, l'ange protecteur des jeunes
néophytes, fut Leli Badé, dont la fille a épousé M. Jules Panchaud. Inutile
de dire que jamais arbustes n'ont reçu, dès le berceau, de plus fortifiantes
caresses. Jamais non plus un potager n'a vu plus riche végétation que cette
place : pois géants, fèves colossales, patates merveilleuses, et les choux
!!..... Malheureusement tout cela poussait sur des débris d'ossements
humains !" .
Au
centre de ce petit cimetière, s'élevait une croix de pierre, légèrement
noircie et égrignée par le temps. Elle avait traversé les jours de la
Révolution. Pourquoi, et par qui fut-elle démolie sous le pastorat de M.
Dubordieu ?
Quels que soient les motifs, et l'auteur que je n'ai pu sûrement connaître,
il faut les blâmer. Démolir une croix, jamais, à moins que ce ne soit pour
la faire plus belle".
J'attire
l'attention du lecteur sur l'adjectif égrigné qu'il aura bien du mal
à trouver dans un dictionnaire. Il est mentionné dans une analyse du patois
rochelais de 1780 qui indique que le verbe égrigner signifiait : écailler,
écorner. On l'a retrouvé dans les expressions grigner les grenons
(froncer les sourcils) et grigner des dents (grincer des
dents).
La
place du télégraphe changera de nom, le 10 septembre
1876, par décision du conseil municipal : elle deviendra "Place
Chevelaure en souvenir de Monsieur Chevelaure, ancien propriétaire dans la
palus, le généreux bienfaiteur des pauvres de l'église de Bouliac."
****
La tour à gauche , premier relais de la
ligne Bordeaux-Bayonne, est située à Gradignan dans le parc de l'Institut
des Jeunes Sourds. Elle a fonctionné de 1823 à 1853. Elle faisait partie des
110 stations de cette ligne.
On peut imaginer une tour identique
occupant l'emplacement actuel du Monument aux Morts. Imaginons... car les
archives communales ont perdu toute mémoire de cette tour ! |
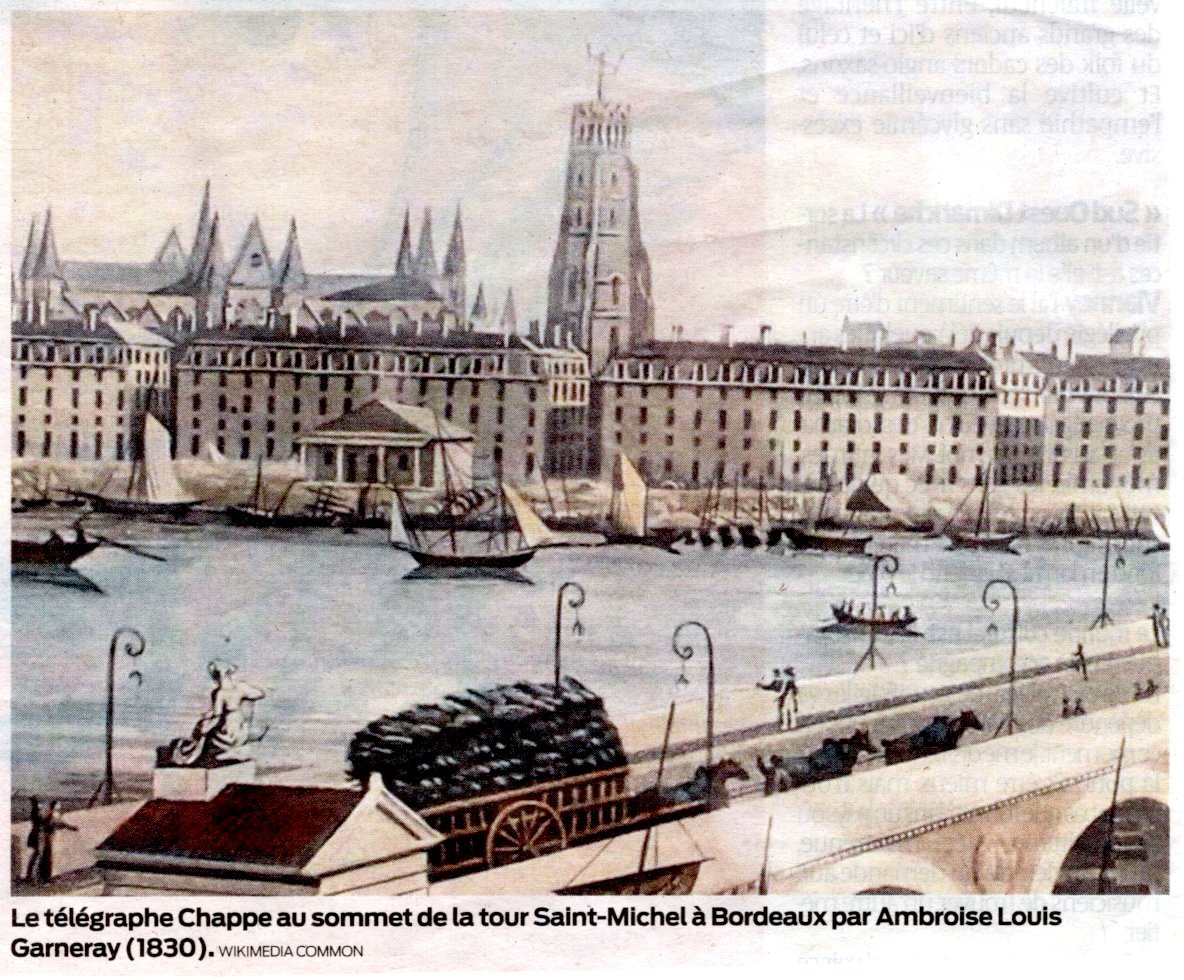

Sur ce tableau de
1850, on perçoit, à gauche, la tour Saint-Michel, terminée par la station du
télégraphe optique qui laissera sa place à la flèche qu'on voit en 2009.
La tache éclatante, au centre du tableau, a été produite par le flash de
l'appareil photographique;
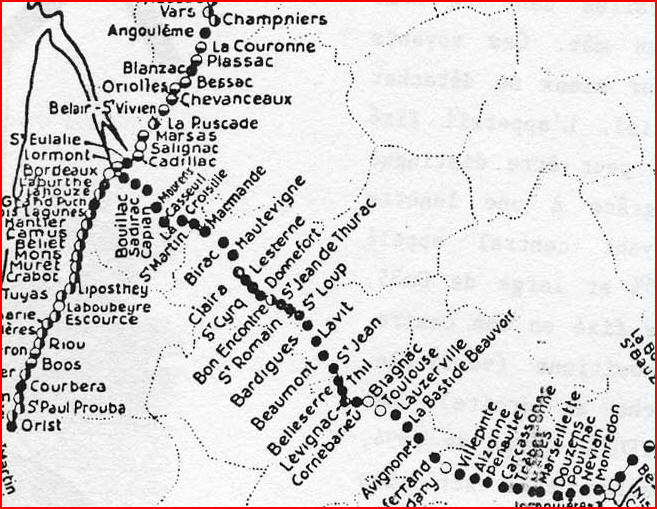
Extrait d'une carte montrant
Bouillac
(!) et Sadirac
en tête de ligne.
Victor Hugo a vu le
télégraphe de la tour Saint-Michel en 1843
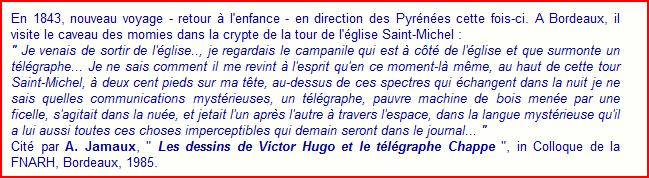
La tour
du télégraphe optique à Sadirac
La
Mairie de Sadirac a publié quelques renseignements relatifs à ce deuxième relais
de la ligne Bordeaux - Narbonne
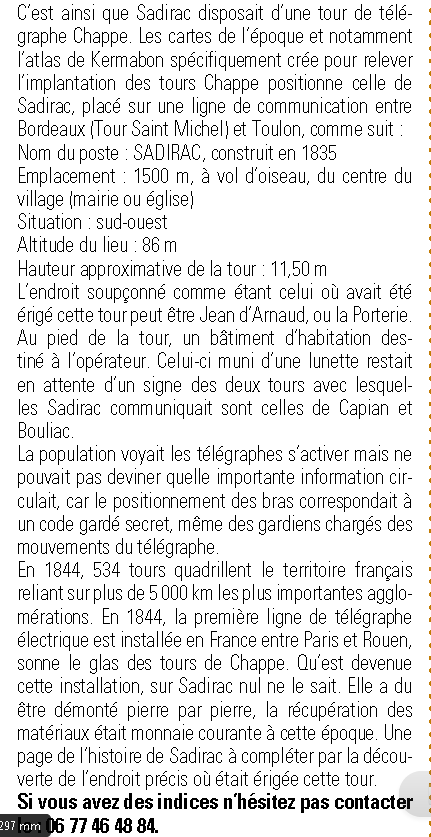
La commune de Capian, possède les vestiges du troisième relais de
la ligne Bordeaux -Narbonne.
Extrait de Les Cahiers de l'Entre-Deux-Mers, Mars-Avril-2005
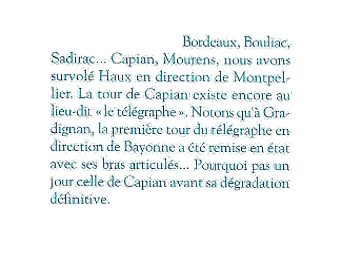
A la fin de la seconde guerre mondiale, la
commune de Bouliac fit ériger un monument aux morts pour la France, sur l'emplacement de la
tour du télégraphe optique.
Le 22
juillet 1928, le Conseil étudia les devis d'un deuxième monument qui
devait être construit au centre du nouveau cimetière (voir la page consacrée aux
cimetières de Bouliac). Le montant des travaux projetés s'élevant à 17500francs,
le Conseil le déclara trop élevé et décida qu'il était nécessaire de
modifier le projet de façon à réduire la dépense à 8000 francs.
Le télégraphe municipal
Cette photographie nous montre une exhibition de la société de
gymnastique, au début du XXème siècle. On remarquera, au-dessus de la porte
centrale de la mairie, l'inscription TELEGRAMME.
La cuisine de Mme Reyt se trouve derrière la première fenêtre
de gauche.
Il est né bien plus tard, à la fin du XIXème
siècle : le 23 octobre 1892, grâce au maire M. Hervouët. Il propose au conseil
de voter une dépense de 1200 francs : 240 francs pour 2 kilomètres de ligne, 310
francs pour la ligne sur poteaux, 250 francs pour les appareils et 400 francs
pour installation de ce matériel.
Le 20 novembre 1892, le conseil apprend que ce
projet a été adopté par le préfet. Deux problèmes restent à résoudre : le local
et le responsable du service. Mme Reyt, l'institutrice contactée par le maire, a
accepté le service de la manipulation mais "à la condition qu'elle sera
autorisée ... à installer le cabinet de manipulation dans sa cuisine. Ce cabinet
aurait 1,65 mètre sur 1,60 mètre de large, soit 2,60 m2 . La cuisine
ayant une surface de 19,80 m2 , l'institutrice disposerait encore de
17, 16 m2 , surface plus que suffisante pour les besoins du
ménage. Le vestibule de la mairie mis en communication avec le cabinet de
manipulation par un guichet tiendrait lieu de salle d'attente."
Pour le responsable du service, le maire envisage une dépense annuelle de trois
cents francs pour Mme Reyt qui aura pour charges : la réception et la
transmission des dépêches, l'entretien du local pour le cabinet de manipulation,
l'éclairage, le chauffage et le nettoyage du local, des frais de bureau et du
traitement du suppléant ou de la suppléante.
Toutes les dépêches reçues seront distribuées gratuitement dans toute la commune
par une personne, nommée par le maire, qui recevra cent francs par an et ne
pourra s'absenter sans se faire remplacer durant tout le temps réglementaire que
le bureau du télégraphe sera ouvert.
Le 11 février 1893, "la fille Soupire, le facteur
municipal engagé pour un an, pour la distribution des télégrammes, refuse de
renouveler son engagement. Elle a écrit à la Gérante, Mme Reyt. Celle-ci a
trouvé une remplaçante pour le même prix, et Melle Pelleterie a été proposée à
l'Administration supérieure."
Le Conseil est informé que la dernière annuité, due à l'Etat, de l'installation
du télégraphe municipal (377 francs) sera versée au cours du mois ainsi que les
frais relatifs au déplacement de la sonnette d'appel du porteur de télégrammes.
Le 3 juin 1894,
le maire rend compte de la souscription lancée dans la commune pour la mise en place du
télégraphe municipal : 1363 francs ont été recueillis alors que le total des
dépenses a été de 1362,98 francs.
Ainsi, en 1894, Bouliac est doté d'un télégraphe
logé à la Mairie et d'un bureau de poste situé sur l'emplacement de l'actuel
bureau de 2010. Le premier a disparu depuis longtemps, le second est toujours
là, mais après avoir connu d'importantes modifications dans les années 1970.
Le 10
février 1896, le Conseil prie le
préfet de bien vouloir faire les démarches nécessaires auprès de
l'Administration des Postes et Télégraphes pour que quelques poteaux
télégraphiques, qui par suite de la réfection du chemin n° 7 dit de Vimeney se
trouvent loin du fossé, soient reportés sur le bord du fossé.
Le 26
mars 1914, le Conseil prend connaissance de la cessation des fonctions de
Marie Pelleterie (en fonction depuis 1893). A l'unanimité, Nizida Bouluguet est
choisie pour lui succéder.