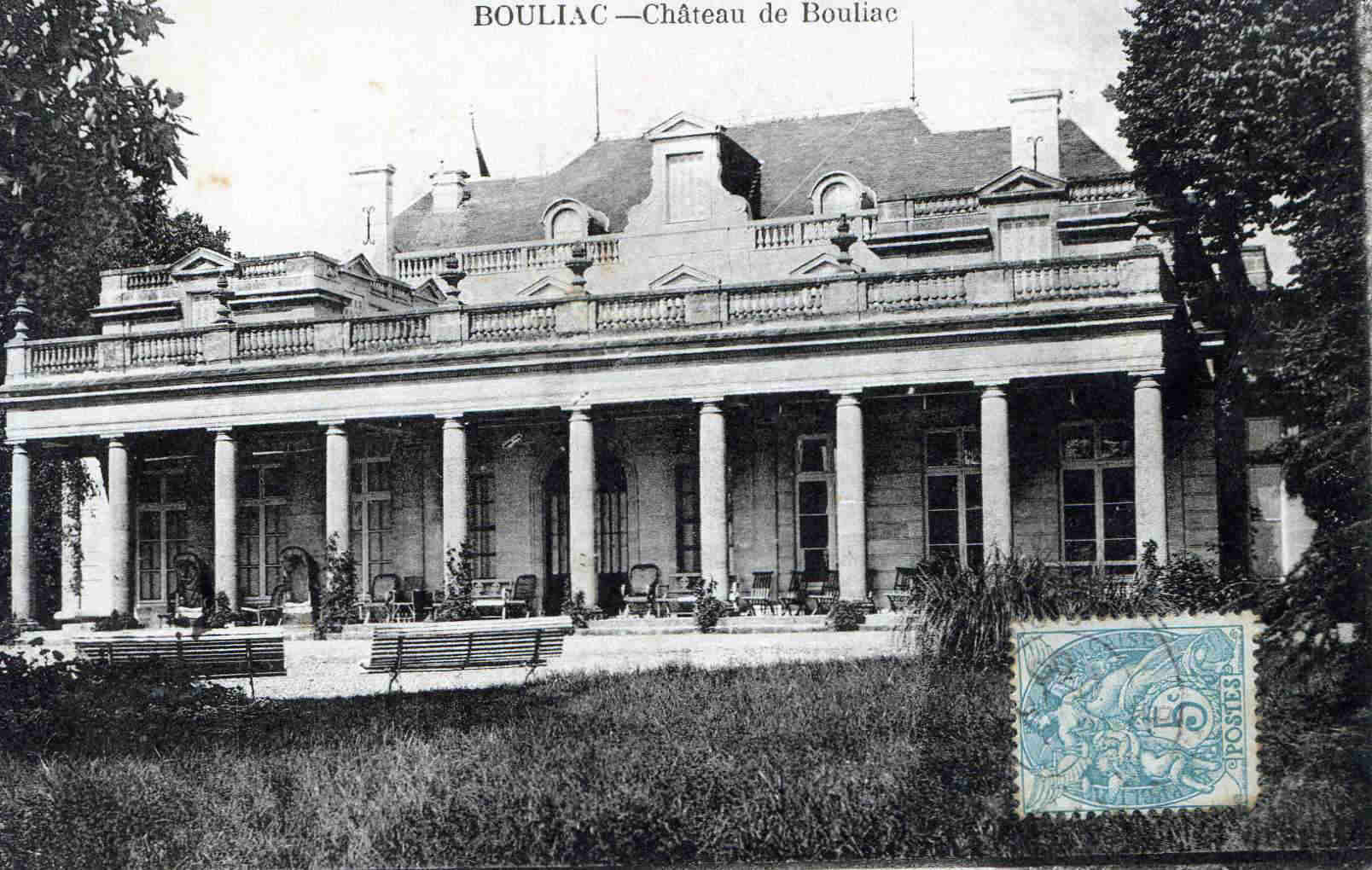
Avant 1945
Collection personnelle
Château de Bouliac
ou
Château de l'Ange
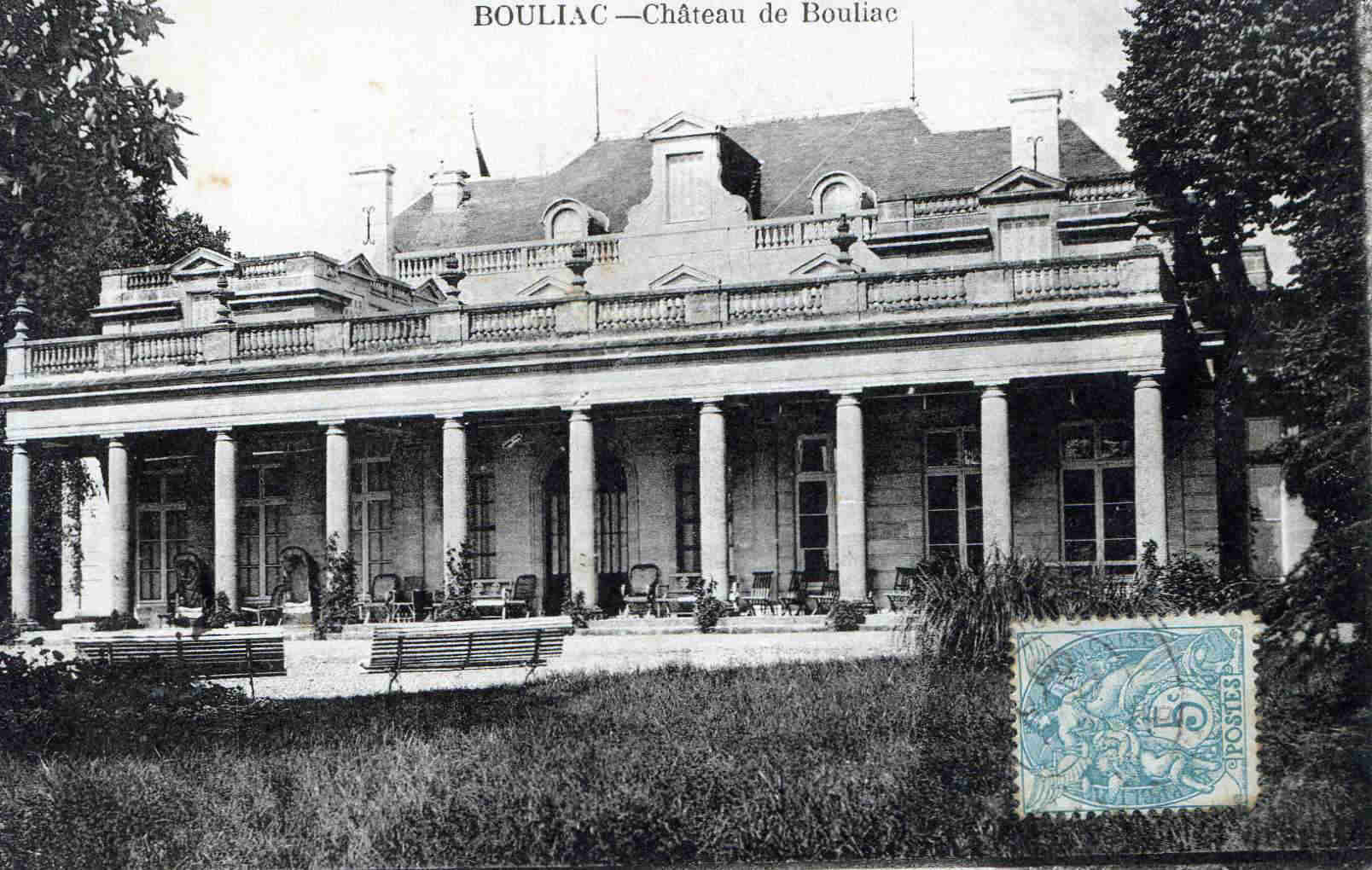 |
|
Avant 1945 |
|
|
|
|
Le château de Bouliac au début du xxème siècle. |
|
Historique
Les textes, dessin et
photos qui suivent sont tirés de l'ouvrage de D. Thomas : Maisons de campagne à
Bouliac et Latresne 1750-1880
"Ce nom de château de l'Ange vient d'une maison ancienne, bâtie à cet endroit, près de laquelle était une fontaine ornée d'une pierre sculptée représentant un ange. En 1824, cette maison appartenait à J.-B. Martin; elle fut achetée en 1837, par un négociant C. De Schriver, qui vendit le domaine à E. Cruze en 1862.
Le château fut bâti à partir de 1864 et terminé en 1866 ou 1867, par Edouard Cruse, négociant, et consul de Hambourg; à Floirac, les châteaux : "La Cruz" et Bel Sito" furent bâtis en même temps par des familles alliées. Sous le Second Empire, le commerce bordelais connut un nouvel âge d'or qui favorisa les constructions.
"...le dessin de Lallemand nous montre d'importants bâtiments d'exploitation qui devaient renfermer des écuries, cuvier et chai pour exploiter les vignes qui donnaient 30 à 35 tonneaux de vin."
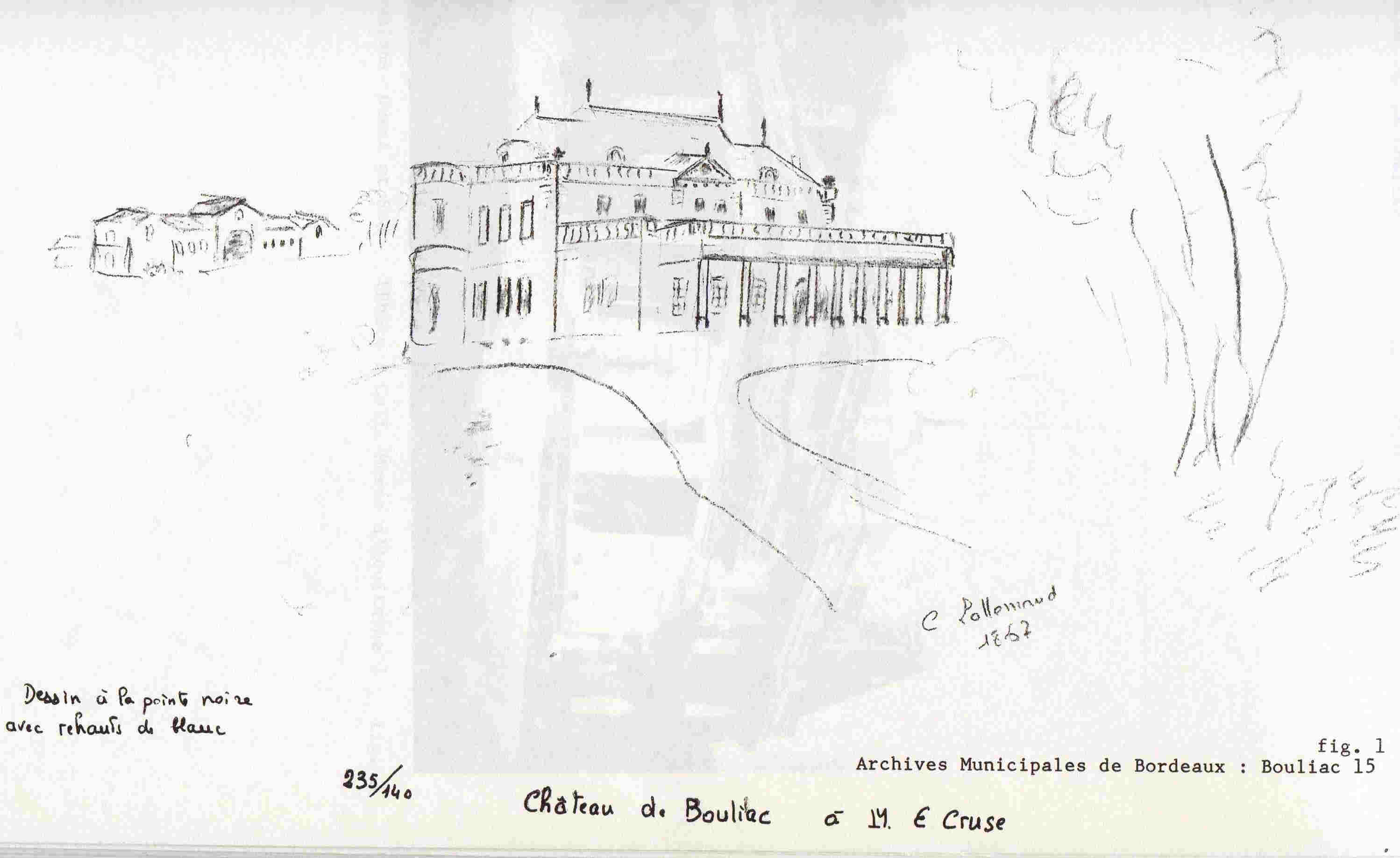
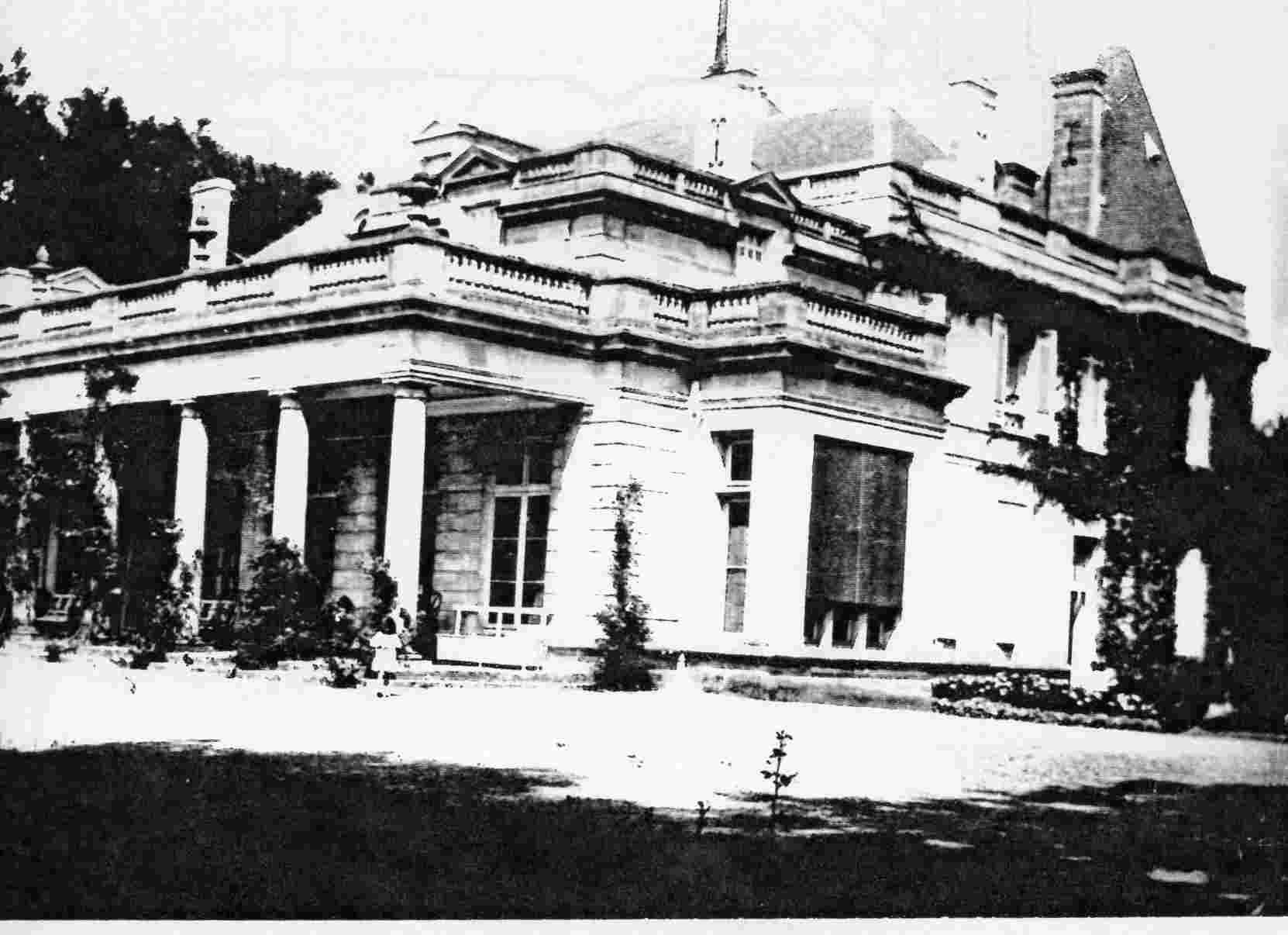
Façade Ouest ( vers Bègles) et Sud (vers le bourg)
La page qui suit est empruntée au site
www.ville-bouliac.fr/beteille
Cet édifice se trouvait autrefois sur le site actuel du quartier Béteille.
I - HISTORIQUE
Originellement, le château de Bouliac nous est connu par une description
originale d’E. GUILLON, et par un dessin à la pointe noire rehaussé de blanc
daté de 1867 exécuté par C. LALLEMAND, célèbre dessinateur du journal "
l’Illustration ". Quelques cartes postales du début du siècle sont également
conservées au Musée d’Aquitaine de Bordeaux. Le château, appelé " Château à
l’Ange ", vient d’une maison ancienne, bâtie à cet endroit, près de laquelle
était une fontaine ornée d’une pierre sculptée représentant un ange. L’eau qui
en coulait était d’après les témoignages non potable et les paysans retrouvaient
souvent leurs vaches empoisonnées à côté de cette fontaine.
En 1824, cette
maison appartient à J.B. MARTIN; elle est achetée en 1837 par un
négociant en vin bordelais César-Louis de SCHRIVER qui la vend à Edouard CRUSE
en 1862. Ce dernier est consul de Hambourg à Floirac en 1842. Il se marie en
1848 avec Suzanne-Sophie BALGUERIE, fille de Pierre BALGUERIE négociant en vin
et grand armateur bordelais. La famille Cruse était une famille germanique
originaire du duché de Holstein, alors danois. La famille Balguerie, quant à
elle, est originaire de l’agenais et du Languedoc. Famille protestante, elle
émigre pour Bordeaux vers 1685, à la suite de la révocation de l’Edit de Nantes
et fait fortune en construisant les navires destinés au trafic triangulaire
(commerce des esclaves noirs). Elle s’orientera plus tard dans le commerce des
vins de Bordeaux. Les fortunes des grandes familles bordelaises se sont faites à
cette époque. Elles se sont maintenues par le jeu des alliances, ce qui
constitue une " oligarchie " bordelaise. La construction du château débute à
partir de 1864 et s'achève en 1869. Les châteaux " La Cruz " et " Bel Sito "
seront bâtis en même temps par des familles alliées. La famille CRUSE,
propriétaire de nombreux châteaux, décide à la fin du siècle dernier de se
séparer du domaine de Bouliac. Il est vendu à Monsieur Paul-Henri DUROCHER,
ingénieur de l’Ecole Centrale de PARIS, qui demeurait 27, rue Cambon. Le hasard
fait que ce dernier, endetté, est dans l'obligation de vendre le château de
Bouliac aux enchères. Le mardi 26 août 1924 à 13 heures 30, Humbert Balguerie
se présente au palais de justice de Bordeaux et se porte acquéreur du château
pour une somme d’environ 420.000 Francs. Je pense que c'était l’occasion
pour lui de voir revenir le domaine dans le patrimoine familial. Madame
Balguerie ne me l’a pas confirmé, mais son regard semblait me dire le contraire.
De plus, Monsieur DUROCHER devait 408.335 Francs à un certain Humbert Balguerie...
L’affiche de mise en vente du château qu’elle a bien voulu me confier a été pour
moi une mine de renseignements. En voici par exemple un extrait : "Aux
requêtes, poursuites et diligences de Monsieur Humbert Balguerie, courtier
maritime, demeurant place Richelieu à Bordeaux. Il est procédé contre et au
préjudice de M. Paul-Henri Durocher, à la saisie et vente des biens suivants :
Elle est percée : 1° en façade, sous la marquise, d’une grande porte vitrée et
de neuf fenêtres; 2° en façade, sur le parc, d’une porte vitrée à laquelle on
accède par un perron, et de six fenêtres au rez-de-chaussée, au premier étage de
sept fenêtres; 3° du côté droit, au rez-de-chaussée, de cinq fenêtres et d’une
grande baie vitrée, et au premier étage de cinq fenêtres; 4° du côté gauche, au
rez-de-chaussée, d’une petite porte en bois plein, de quatre fenêtres et d’une
grande baie vitrée; au premier étage, de cinq fenêtres. La toiture est surmontée
de plusieurs superstructures. A - Une belle construction, en forme de château,
bâtie en pierres de taille, couverte en ardoises, élevée sur caves d’un
rez-de-chaussée et d’un premier étage, avec combles sur parties. Sur la façade,
côté du fleuve, existe une marquise en pierres soutenue par des colonnades,
également en pierres. Elle est surmontée d’une terrasse. B - Un corps de
bâtiments en briques et pierres, couvert en tuiles, à usage d’habitation de
paysan, chai, grenier, exploitation, avec au centre un grand portique cintré. Le
sol sur lequel il est construit est d’une superficie d’environ 500 mètres
carrés. C - Une construction en pierres couverte en tuiles, située près du
portail d’entrée, actuellement à usage d’habitation de concierge. Parcs, bois,
jardin, terre, prés, vignes et autres natures de sol, entourés de murs et
treillages avec grille d’entrée métallique à deux battants sur la route de
Bordeaux à Saint-Macaire. Le tout vendu pour un seul ensemble d’une superficie
totale d’environ trente-sept hectares quatre-vingt-quatorze ares et
quarante-huit centiares. L’ ensemble de la propriété est exploité par Monsieur
BRUN, ingénieur. "
Avant la deuxième guerre mondiale, la famille Balguerie décide de louer le
château et d’aller habiter son hôtel particulier de Bordeaux. Il est alors
loué aux demoiselles de Malakoff.
II - DESCRIPTION
Situé au nord de la commune, le château était entouré d’un vaste parc dominant
le vallon du Rébédech qui sépare Bouliac de Floirac. Comme l’on peut le voir sur
le dessin de C. LALLEMAND, il comportait d’importants bâtiments d’exploitation
qui renfermaient des écuries, un cuvier, et un chai pour exploiter les vignes
qui donnaient 30 à 35 tonneaux de vin (Surtout du vin blanc). Ce qui peut
paraître peu pour nous aujourd’hui représentait pour l’époque une surface
viticole de 10 à 15 hectares. Les bâtiments d’exploitation étaient situés à
l’emplacement des logements officiers. Des fondations sont encore apparentes en
haut à droite de l’allée bétonnée qui y monte. J’ai retrouvé des restes de
briques, d’ardoises et de tuiles provenant de l’écurie. " Le château proprement
dit était situé entre le bâtiment 3 et le bâtiment officier. Il était orienté
vers la Garonne et dominait la ville de Bègles. Construit sur le même plan que
les dépendances, il était massé à trois niveaux limités :
Rez de-chaussée, étage carré et un étage de combles d’où s’élevaient plusieurs
corps de bâtiments difficiles à identifier.
Sur la façade ouest, un péristyle à dix colonnes d’ordre toscan supportait une
large terrasse. Madame Balguerie m’a dit qu’un des plaisirs de son beau-père
était d’observer à la longue vue les ouvriers affairés à charger les tonneaux de
vin sur le port de Bègles. Sur le corps de bâtiment principal, un avant corps à
refends était surmonté d’un fronton où se trouvait très certainement le
monogramme de la famille Cruse. C’était très courant à l’époque. Des balustrades
en pierres couronnaient le péristyle et le premier étage comme l’on peut le voir
sur les photographies. Les toits du château étaient en ardoises et en tuiles
creuses de gironde pour les dépendances. A l’origine, les tours du château
étaient rondes et ornées de terrasses. Nous pouvons nous apercevoir que ces
dernières ont été couvertes de toits en pavillon, peut-être au début du siècle.
Personne n’a pu me donner le nom exact de l’architecte du château, mais
certaines sources avancent le nom d’un illustre bâtisseur de l’époque : V.
MIALHE.
L’entrée principale se trouvait au niveau de notre poste de sécurité et la
maison du gardien était notre " petite maison dans la prairie ". Les portes
d’entrées étaient en fer forgé, monogrammées, et tenues par trois ou quatre
piliers en pierres carrées. Le chemin permettant d’accéder au château, " l’allée
des roses ", était celui qui passe au-dessus de l’escalier en béton, certaines
pierres de soutènement s’y trouvent encore. On arrivait par la ferme où se
trouvait un très beau poulailler, ce qui était prémonitoire pour la suite...
Les cèdres, les magnolias du parc ainsi que les séquoias qui bordent le chemin
d’accès au château ont été importés et plantés vers 1870 par Edouard Cruse. Un
puits existait au niveau du parking du bâtiment 1 et alimentait les bâtiments
d’exploitation. Un deuxième, beaucoup plus profond, se trouvait devant le
bâtiment 6 à l’angle du prés et de la place du marché. Lorsqu’il pleut, la route
est toujours trempée à cet endroit car le puits déborde...
Deux pigeonniers avaient place semble t-il au niveau de la station d’épuration
et au virage à gauche du bâtiment 16.
III - LA FIN DU CHATEAU
Au début de la guerre, le château est réquisitionné par la marine allemande. Le
propriétaire doit malgré lui se soumettre à cet ordre. Les soldats installent
une tourelle sur une terrasse afin de mitrailler les avions anglais qui partent
bombarder la base sous-marine de Bordeaux. D’après Madame Balguerie, ils n’ont
pas détérioré le château, mais il est vrai que de la peinture verte était
largement répandue sur les murs extérieurs. Un peu avant la libération de
Bordeaux, les allemands décident de quitter le château. Etant donné l’urgence de
la situation, ils n’ont pas le temps de vider les caves pleines de munitions de
toutes sortes. Au début du mois d’août 1944, ils commencent à prévenir la
population de leurs intentions. Les bouliacais se souviennent des véhicules
qui passaient dans toute la commune pour inviter les gens à se retirer sur
Tresses ou même Fargues Saint Hilaire. Le 29 août, un peu avant minuit, ils
l’illuminent une dernière fois et la première explosion se produit. Une deuxième
se fait entendre un peu plus tard. Un immense panache de fumée s'élève alors
dans le ciel. Il se voyait parait-il depuis Fargues. Pendant quelque temps,
la population n'essaie pas d’aller voir le résultat de l’explosion, et
d’ailleurs tout le monde a autre chose à faire à cette époque. On savait bien
que ces obus étaient tombés un peu partout dans le village. Une vache avait été
tuée par la retombée d’un projectile au hameau d’epsom (Monsieur Caillou de
Bouliac s’en souvient). Un accident bien plus grave arrive pourtant. Le 5
novembre 1944, une petite équipe de jeunes essaie bien avec l’aide d’un F.F.I.
nouvellement enrôlé de désamorcer un obus tombé à côté du cimetière. Neuf
d’entre eux sont tués et deux très gravement blessés. L’histoire du château
finit donc ce jour, et beaucoup de monde connaît la suite. La propriété est
vendue en 1954 à l’O.R.T.F., qui elle même vendra 23 hectares à la gendarmerie.
Le Gendarme
SEURIN, Laurent (auteur de ce document)
Le Gendarme SAUVAGET, Philippe (pour la mise en ligne)
Tous nos
remerciements aux organismes ou personnes suivantes :
- Archives départementales de Bordeaux,
- Madame LANDET (mairie de Bouliac),
- Madame THOMAS pour sa thèse sur les maisons de campagnes à Bouliac,
- Messieurs et Mesdames Caillou, Glayau, Monsion, Rouzier...
- Monsieur le curé de Bouliac,
Sans oublier bien sûr Madame Balguerie, pour ses souvenirs, et certaines
photographies qu’elle a bien voulu nous prêter.
Mise au point :
Dans la page du Gendarme Seurin deux points demandent rectification :
1- la date du 5 novembre 1944 indiquée pour l'explosion correspond à celle du
décès de Jeanine Glayau qui, d'après son frère Albert Glayau, est morte trois
jours après le drame.
2- la date du 29 août donnée pour l'explosion du château ne me paraît pas
compatible avec la connaissance que nous avons de l'abandon de Bordeaux par les
allemands en août 1944. En effet, dans Bordeaux au XXe siècle, on lit :
"Si la plupart des échelons d'arrière-garde allemands franchirent le pont de
pierre au soir du 26 août...Depuis le 10 août, une agitation fébrile régnait
dans les milieux allemands...De nuit comme de jour se succèdent bientôt les
explosions provenant des stocks de munitions qui sautent, les lueurs d'incendies
de ddépôts de carburants qui flambent... Le long des quais, sur le pont de
pierre, avenue Thiers, défile, lamentable, ce qui paraît être les débris de la
Wehrmacht : chariots traînés par des mules landaises, que mènent les muletiers
pour préserver leur capital; camions essoufflés, tirant des véhicules insolites;
soldats débraillés et recrus de fatigue, qui remontent du Sud pyrénéen, harcelés
par les maquisards. Sur le fleuve, les explosions se succèdent et les navires
lentement s'enfoncent sous les eaux ou se couchent sur le flanc...au verso d'une
affiche du général Nake est rédigée la convention suivante : "Toute les troupes
des Armées allemandes d'occupation devront avoir définitivement quitté la ville
de Bordeaux le dimanche 27 août, à minuit au plus tard...Les troupes américaines
et alliées, ainsi que le maquis, ne pourront occuper la ville qu'à partir de 0
heure et une minute, lundi matin 28 août 1944."
Compte tenu de ces indications, la date du 29 août ne me paraît pas acceptable;
personnellement, je propose le 26 août, vers trois heures du matin, comme date
de l'explosion.
Quelle mémoire bouliacaise pourra nous donner la date exacte de cette explosion qui fit disparaître le château de l'Ange ?
Je me souviens...
dit Anny Béziat-Caillou
que ma belle -mère, Denise Maurac-Caillou, évoquait, entre les deux guerres, les vendanges dans les vignes du château de l'ange; les jeunes de la commune participaient à la cueillette du raisin. A l'heure du repas, on étendait une grande nappe, sur l'herbe, près de la fontaine où les bouteilles avaient été mises à rafraîchir sous la surveillance de l'ange ! On ouvrait alors les paniers pour étaler pain, saucissons , pâtés et tartes confectionnés à la maison. C'était un grand moment de détente et de remise en forme avant de revenir dans la vigne, légèrement grisés, mais l'eau de la fontaine n'y était pour rien !
Je me souviens...de l'explosion du château deBouliac
dit Anne-Marie Serre-Simounet
J'avais sept ans ! Le 25 août 1944
les soldats allemands s'apprêtent à quitter Bordeaux et les communes voisines.
Dans le château de l'Ange ils ont entreposé un stock énorme de munitions. Ils
ont décidé de le faire exploser avant de quitter le château pour ne rien laisser
aux forces de libération qui remontent vers Bordeaux. On peut imaginer qu' un
élan humanitaire les a poussés à informer les habitants du village. Un groupe de
soldats vient prévenir Mr Bouc (à l'angle de la côte en allant vers le bourg)
qui, déjà couché, ne se lève pas. M. Crémier, le forgeron du village, alerté par
les éclats de voix, sort de sa maison. C'est lui qui recevra le message des
soldats : "Le château va sauter, allez vous mettre à l'abri !" Il est environ
onze heures du soir. Le bouche à oreille fonctionne aussitôt, la nouvelle se
répand. Les habitants quittent leurs lits, leurs maisons et, par petits groupes,
se dirigent, sans perdre une minute, vers les chemins qui descendent vers
le vallon (chemin de Berliquet, aujourd'hui rue Louis Brochard, chemin de
Robardeau qui longe le terrain de sport pour aller vers le ruisseau de Fourney).
Il fait nuit noire, il fait chaud, le ciel est criblé d'étoiles, la peur est
chez tous, petits et grands. Quelques hommes ont refusé de quitter la place de
la mairie, inconscience du danger, parade de virilité ou bravade, qui pourrait
le dire ?
Nous attendons, couchés dans l'herbe, le temps paraît long, rien ne bouge, rien
n'explose ! Vers minuit, une heure peut-être, certains décident de revenir au
village, supposant que c'était une fausse alerte ou que les Allemands avaient
renoncé à leur projet destructeur. D'autres, plus prudents ou plus inquiets,
restent allongés dans les fossés.
Je me souviens de m'être recouchée sans mon petit lit d'enfant de 7 ans, dans la
chambre de mes parents. Une énorme explosion secoue la maison et mon lit, les
vitres explosent, le plâtre du plafond se fissure, des plaques tombent sur le
plancher. Il est trois heures du matin.
Au petit matin, la place de la mairie sera trouvée jonchée d'éclats de vitres
car la déflagration a été d'une force extraordinaire.
"C'était comme si on était soulevé se terre" m'a dit Maria Guttierez.
"C'était comme un énorme feu d'artifice, le ciel était rouge avec des flammes
qui retombaient vers Malus, j'ai cru qu'on allait brûler, le lendemain on a
trouvé une mitraillette au fond du jardin, tous les contrevents étaient ouverts
et les fenêtres sans vitres" se rappelle Paulette Rambaud-Pavin.
Au matin, nous avons appris que tous les Allemands avaient quitté le village. Le
beau château de Bouliac n'avait plus de toit, et ne restaient que des pans
de murs noircis et muets comme témoins de son anéantissement.
Je me souviens... de la tragédie du mois
de
novembre 1944
Anne-Marie Serre-Simounet
L'explosion du château de l' Ange avait
causé bien des dégâts matériels et une grande frayeur générale mais,
quelque temps plus tard elle eut une suite dramatique!
C'était un dimanche après midi du mois de novembre 1944. Un groupe de onze
jeunes adolescents se promenaient dans les chemins de Bouliac.
Au bord d'un talus, chemin de la Belle Etoile, près de la maison des Salé
( aujourd'hui Domaine de Saure), ils découvrirent un obus! La curiosité des
garçons les poussa à le prendre dans leurs mains pour tenter, probablement
, de le désamorcer. L'engin explosa dans la main de celui qui le tenait et ce
fut la tragédie! Des jeunes de Carignan ( de la famille Gizard entre autres) et
de Bouliac ( de la famille Glayau) moururent là! Trois jeunes filles Glayau
furent transportées à l'hôpital : Jeanine, par manque de sang à transfuser,
mourut trois jours après, le 5 Novembre; sa soeur Josette garda des éclats
d'obus dans le visage mais en sortit rescapée ainsi que leur jeune soeur
Denise qui, malheureusement, perdit une jambe.
J'avais sept ans alors mais, curieuse et partageant la panique générale, je réussis à me mêler à l'agitation qui régnait sur la place et j'ai le souvenir de grandes bâches vertes recouvrant les corps dans le couloir de la mairie où régnait une odeur fade et lourde en même temps. Trois ou quatre familles furent ainsi cruellement frappées alors que les Allemands avaient quitté la région.
.Je
me souviens...
Michel Laborde, le Coteau
Habitant le chemin de Vimeney, j'ai connu l'explosion du château (de loin), j'ai joué avec des grenades allemandes désamorcées !!

Le château après l'explosion en août 1944
En 1874, le château de Bouliac produisait 125 tonneaux de vin rouge , soit 1 000 barriques. Des milliers de bouteilles ont dû porter l'étiquette ci-dessous.
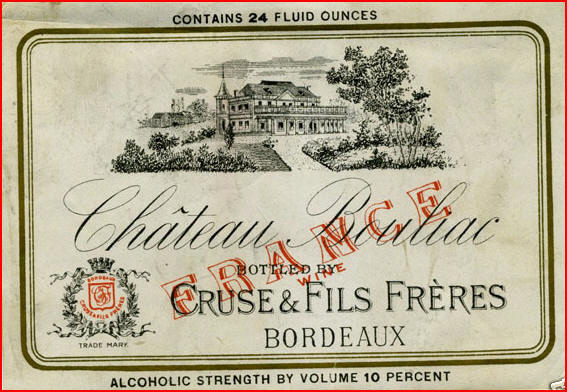
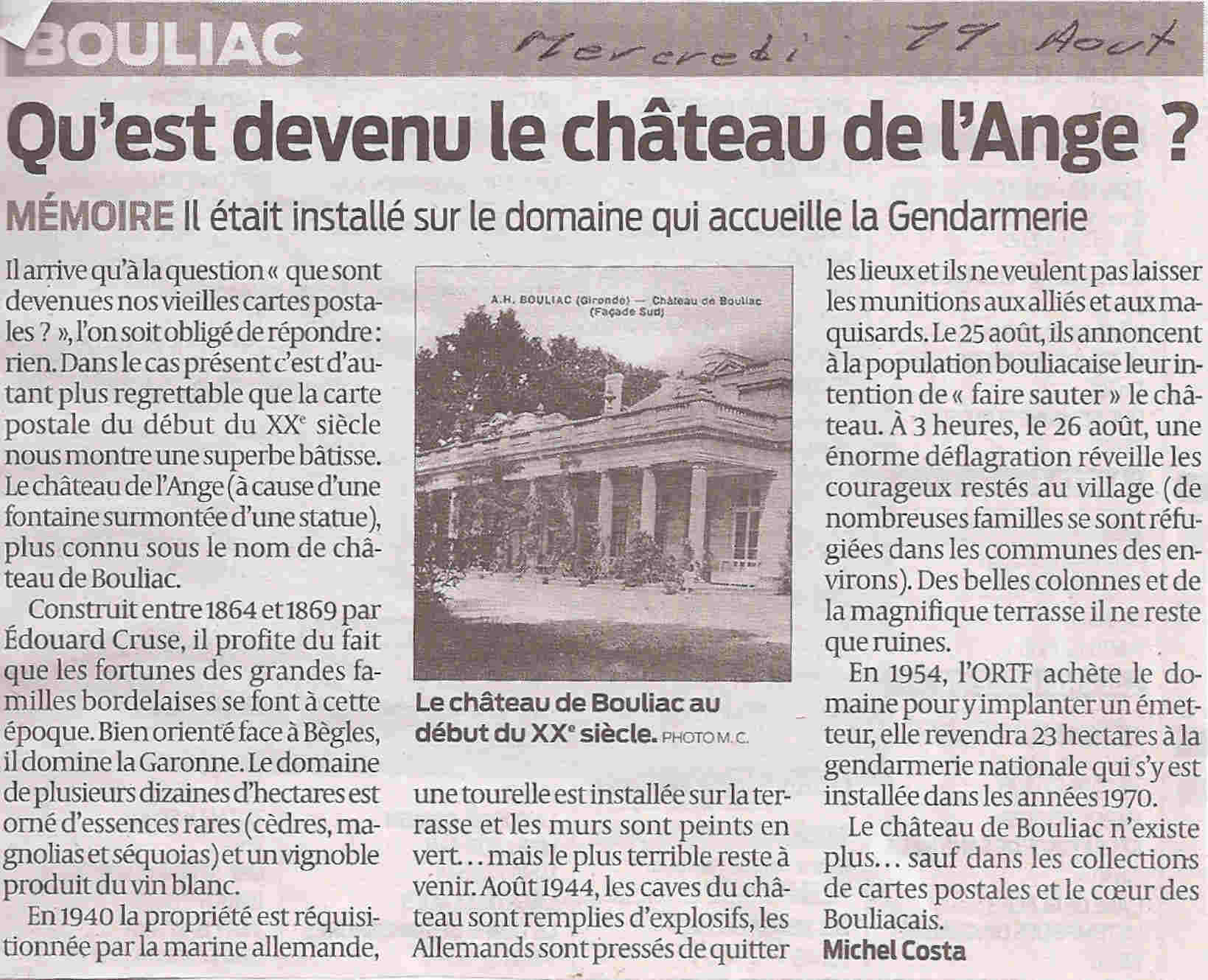
L'article de Michel Costa dans le journal Sud-Ouest du 19 août 2009
Le saviez-vous ?

Sur cette vue aérienne, prise en 1930, on perçoit l'entrée d'une galerie aujourd'hui disparue.
Elle était située à l'entrée du chemin de Salles.